
Formé au milieu des années 80, le bien nommé Pigalle connait son heure de gloire en 1990 avec son second album au titre imprononçable « Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais o combien attachant ».
Pigalle est une version plus rock/chanson française des Garçons Bouchers l’autre groupe punk de François Hadji-Lazaro, auteur compositeur chanteur et multi instrumentiste.
Robert Basarte (guitare), Thierry Svahn (piano/synthétiseurs), Riton Mitsouko (basse) et Joe (batterie) vient compléter la formation atour du gros type au crane rasé.
Avec sa pochette triste et belle dessinée par Tardi, « Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais o combien attachant », débute par « Ecris moi » morceau lent et obsédant qui propage un certain malaise diffus.
On appréciera plus « Marie le rouquine », rapide, entrainant, qui met en évidence les textes d’un réalisme puissant de Hadji-Lazaro portée par sa grosse voix.
« Marie la rouquine » raconte durant les années folles, la destinée tragique d’une prostituée bretonne venue chercher fortune à Paris avant de connaitre la déchéance et les bordels pour mineurs de l’Est de la France.
Difficile en revanche de supporter « Une nuit » texte érotico-pornographique peu ragoutant, déclamé d’une voix monotone pendant trois longues minutes plus que pénibles.
Malgré son originalité musicale et une certaine profondeur quasi philosophique « Le tourbillon » lasse par son rythme volontairement décousu.
Le punch du groupe s’exerce sur « Y’a l’aventure » rapide et gouailleur comme un titi d’un Paris qui n’existe plus que dans certains fantasmes.
On calme un peu le jeu sur le court et mélodique « Premières fois » qui laisse cependant un fort gout d’inachevé, avant que ne surgisse « Les lettres de l’autoroute » poignant récit d’un travailleur exilé à sa famille, qui construit dans des conditions épouvantable une autoroute.
Combinant richesse du texte et magnifique mélodie de banjo, « Les lettres de l’autoroute » a pour moi tous les ingrédients d’un authentique chef d’œuvre noir.
Ce morceau magnifique sera pourtant éclipsé pour l’histoire par « Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs » authentique tube à l’entrainant orgue de barbarie qui ne saurait pourtant faire oublier le fond incroyablement sombre et sordide du Pigalle des voyous.
Après ce petit festival vient « Sophie de Nantes » calme et mélancolique, « Eternel salaud » étrange hybride introduisant des claviers pop trop écrasants à mon gout.
On verse dans la nostalgie sur « Chez Pascal et Ronan » en mémoire d’un temps oublié dédié aux soirées de l’underground avec alcool, musique et parfois baston.
Pigalle se fait plus agressif avec « Dans les prisons » qui flirte parfois avec le punk dur et rapide.
Les femmes sont encore à l’honneur sur « Angèle » court hommage finalement assez joli et élégant avant que ne vienne l’un des meilleurs titres de l’album « En haut, en bas » magnifique description d’une fin de journée à Paris vu des tours, ce que en tant qu’habitant du treizième arrondissement je ne peux qu’apprécier.
Voix rauque, ton pesant et triste sur « Le chaland » puis émotion à fleur de peau sur « Un petit paradis » évoquant encore la nostalgie des bars-cabarets des portes de Paris.
Les deux derniers morceaux, « Paris le soir » et « Renaitre » s’étalent ensuite, magnifiques folks beaux et tristes à pleurer.
En conclusion, « Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais o combien attachant » est une véritable plongée dans l’univers artistique assez incomparable de Pigalle axée sur le Paris des bas cotés, le monde de la nuit, des bars, des musiciens, des voyous, des camés et des prostituées.
Cette véritable poésie urbaine se construit autour des textes brillants et parfois géniaux de Hadji-Lazaro très inspiré par les légendes de personnages hauts en couleur du bitume parisien.
La musique contient elle plusieurs ingrédients : le rock bien sur mais aussi la chanson française, le folk US tout en émotion à fleur de peau.
Porté par le succès de « Dans la salle tabac de la rue des martyrs« , « Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais o combien attachant » permet bien d’appréhender le talent d’un groupe unique et inclassable, sans doute resté trop underground et véritable antidote à David Guetta.
commenter cet article …









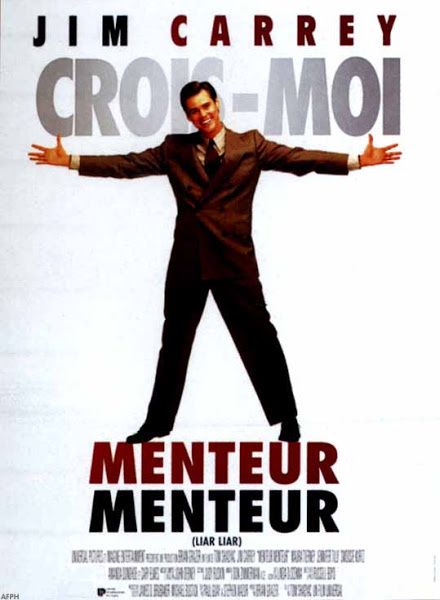











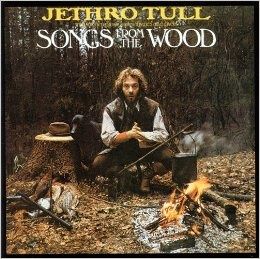

/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)