
Fin de mois de Novembre oblige, Alice in chains est pour moi le parfait groupe pour quitter un automne finissant et trouver devant soi un hiver forcément déprimant.
Sorti en 2012, « The devil put dinosaurs here » confirme le retour des américains sur le devant de la scène et la stabilisation de William Duvall au poste de chanteur.
Entre « Black gives way to blue » sorti trois ans auparavant, Mike Starr le bassiste d’origine du groupe a trouvé la mort, plongeant Jerry Cantrell et sa bande dans un nouveau drame hélas plus que prévisible.
Avec sa pochette étrange évoquant la trouble passion du groupe pour les squelettes d’animaux en l’occurrence ici un bon vieux dinosaure, « The devil put dinosaurs here » débute par un « Hollow » combinant à merveille son massif de guitare, rythmiques lentes et mélodies vocales enivrantes pour s’enrouler tel un serpent sur de son fait, patiemment autour de l’auditeur pour ne lui laisser au final aucune chance.
Le ton est donc donné et avec un lancement aussi parfait on embraye sur « Pretty done » et « Stone » certes puissants mais un peu trop denses, lancinants et parfois répétitifs pour donner leur pleine mesure.
Il faut attendre « Voices » pour retrouver le Alice in chains acoustique jouant à merveille sur les émotions véhiculées par des mélodies élégantes et dépouillées.
Les prodiges de Seattle place ensuite un tube digne de leurs plus belles années avec « The devil put dinosaurs here » merveille d’harmonies vocales surnaturelles culminant en des refrains transcendants.
Après ce titre grandiose figeant le temps sur plus de six minutes hypnotiques, l’intensité chute sur « Lab monkey » et « Low ceiling » en comparaison beaucoup plus quelconques voir un tantinet linéaire et ennuyeux pour ce dernier.
On s’engouffre dans les sinuités de « Breath on window » et « Scalpel » aux refrains chauds, enveloppants et de belle qualité.
Difficile malgré la qualité des musiciens de ne pas trouver le temps long sur les sept minutes de « Phantom limb ».
Tout en prenant son temps, Alice in chains finit par nous emmener vers la fin du disque, composée du superbe « Hung on a hook » à la beauté ténébreuse et d’un « Choke » agréable mais un peu décevant pour une conclusion.
En conclusion, « The devil put dinosaurs here » est clairement un cran en dessous de son prédécesseur qui contenait des morceaux de classe supérieure.
Alice in chains parait en effet quelque peu en pilotage automatique, créant certes une musique toujours de bonne qualité avec le talent unique de compositeur de Cantrell et la voix si divine de Duvall, mais peine à se renouveler et à surprendre.
Uniquement composé de morceaux lents de plus de quatre minutes, « The devil put dinosaurs here » manque également parfois d’un zeste de punch et de vivacité à l’instar des meilleurs disques des cinq de Seattle.
On passera donc un moment agréable à son écoute sans crier cette fois au génie ni même à l’album majeur.
Dommage …
commenter cet article …











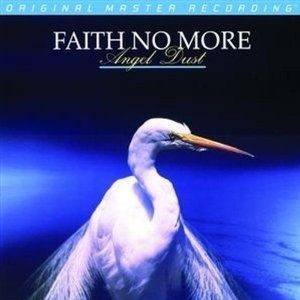











/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)