
Disons le tout de go les années 90 s’avèrent purement catastrophiques pour les Scorpions en panne de repères et de créativité comme le montre le très décrié « Eye to eye ».
Sorti en 1999 avec James Kottak à la batterie, « Eye to eye » et sa pochette minable débutent par « Mysterious » qui introduit déjà un beat électro des plus artificiels et suspects.
Klaus Meine a beau s’échiner à chanter du mieux qu‘il peut, la sauce ne prend guère en raison du rythme plat et froid et de la mise très en retrait des guitares de la paire Rudolf Schenker/Matthias Jabs.
Les dance floors semblent clairement la cible de « To be n°1 » qui évolue tout en légèreté pop avec toute de même l’appui des guitares sur les refrains.
Les ballades vous manquait déjà ? Voici « Obsession » et « 10 light years away » qui déboulent avec de la guimauve alignée au kilomètre et c’est sur des riffs bien timidement déployés que s’entremêle le laborieux « Mind like a tree ».
Nouveau tartinage de ballades transparentes sur « Eye to eye » et « What U give U gave back » qui viennent vous bercer sur chacune cinq longues minutes environ.
La galère vogue toujours en douceur vers le néant au rythme de « Skywritter » et on lève timidement un sourcil sur « Yellow butterfly » un tantinet plus lourd et intéressant.
Retour des grosses machines électro tournant à vide sur « Freshly squeezed », tentative d’un peu d’animation sur le pop « Priscilla ».
Rien ne nous semble épargner avec du rap (!) sur « Du bist so schmutzig » sans doute idéal pour une fête de la bière à Munich et à vrai dire on est pas fâché d’arriver à la fin de ce douloureux marathon formé de « Aleyah » aux gros riffs paresseux/refrains lourdingues et je vous le donne en mille une énième ballade torchon « A moment in a million »
En conclusion, « Eye to eye » est une catastrophe, un reniement absolu du passé des Scorpions qui évoluait dans les années 70 dans un hard progressif particulièrement ambitieux avant de s’orienter vers un heavy metal mélodique mais viril diablement efficace dans les années 80.
En toute honnêteté on ne sait pas très bien ce que cherchent les Allemands avec ce disque, coller à plus de modernité en incorporant un son plus dance ? Séduire un plus large public en versant dans de la pop doucereuse à outrance ? En tout cas les guitares semblent bien mises sous l’éteignoir, tout comme la fibre créatrice et folle du groupe pour proposer un ersatz d’album boursouflé et sans âme.
C’est donc un vieux groupe fatigué semblant à bout d’idées et se raccrocher à la première mauvaise idée foireuse qui lui tombe sous la main qui semble aborder le début du XXI ième siècle.
Rien à retirer donc de ce disque qui fut un échec monumental bien mérité et mit un vrai coup d’arrêt de cinq ans à la carrière des Scorpions ! Et pan !









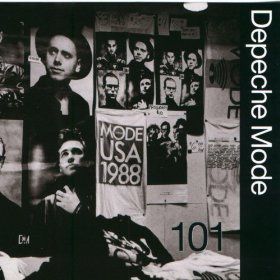

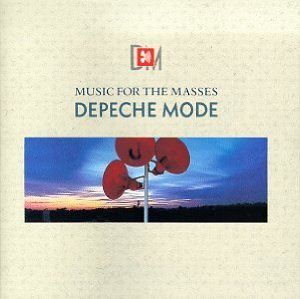




/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)