
Nanti de très bonnes critiques, « Good morning England » de Richard Curtis voit le jour en 2009.
Ce film raconte l’histoire de Radio Rock, qui au milieu des années 60 émettait depuis un navire dans la mer du Nord, pour éviter la censure sévissant en Grande-Bretagne et ainsi diffuser les premiers groupes de pop-rock qui émergeaient à l’époque.
En situation d’échec scolaire, Carl (Tom Sturridge) est envoyé par sa mère Charlotte (Emma Thomson) chez son parrain Quentin (Bill Nighy), pour se remettre les idées en place sur le navire qu’il possède.
En réalité, Quentin dirige Radio Rock et promeut des DJ qui entre deux morceaux de pop-rock, émettent des idées provocatrices.
Le Comte (Philip Seymour Hoffman) est le DJ vedette de la radio, Docteur Dave (Nick Frost), Simon (Chris O‘Dowd), Angus (Rhys Darby), Bob (Ralph Brown) DJ de nuit vivant reclus avec ces disques, Mark (Tom Wisdom) sex symbole muet, le journaliste John (Will Adamsdale), Kevin (Tom Brooke) réputé pour sa bêtise, la cuisinière lesbienne Felicity (Katherine Parkinson) complétant le reste de cette turbulente équipe.
La qualité de la musique mais surtout les propos salaces des DJ font rapidement de Radio Rock une radio très populaire auprès du public, ce qui déplait au gouvernement britannique et pousse le premier ministre britannique Alistair Dormandy (Kenneth Brannagh) à charger un de ses adjoints cavalièrement appelé Troudballe (Jack Davenport) de trouver un moyen de faire cesser ces obscénités.
Carl découvre la vie à bord dans une ambiance rock ‘n’ roll complètement débridé.
Obsédé par l’idée de perdre son pucelage, il rate une occasion en or que lui offre Docteur Dave, qui malgré son obésité, parvient on ne sait trop comment à coucher avec un nombre élevé de femmes au profil de groupies.
Séduit par Marianne (Talulah Riley), la nièce de Quentin présente occasionnellement à bord, Carl temporise, la jouant fleure bleue pour découvrir qu’il a été pris de vitesse par le sex appeal de Docteur Dave.
L’arrivée de Gavin Kavanagh (Rhys Ifans), ex DJ vedette revenu des Etats-Unis pour booster l’audience de Radio Rock pousse encore les DJ à se surpasser dans l’outrance.
Simon tombe follement amoureux d’une femme appelé Eléonore (January Jones) et l’épouse précipitamment pour découvrir que cette femme ne l’aime pas et l’a épouser pour vivre près de Gavin son véritable amour.
Le cœur brisé, Simon trouve du soutien auprès du Comte qui déjà en rivalité avec Gavin le défie en duel pour monter en haut du mat principal du navire.
Gavin ne se dégonfle pas et les deux hommes se retrouve à 20 mètres de haut en pleine mer avant de plonger.
Calmé par le courage de Gavin, le Comte finit par accepter sa domination et la situation s’apaise même avec le malheureux Simon.
L’arrivée de Charlotte à bord provoque un coup de théâtre avec l’annonce que Gavin est la vrai père de Carl alors que Quentin avait été un temps suspecté par le jeune homme complètement perdu.
Ebranlé par la désinvolture de sa mère, Carl finit par voir la réalité en face et se console (enfin !) avec Marianne, avec qui il perd son pucelage avec une retransmission quasiment en live des DJ.
S’en est sans doute trop pour Dormandy qui fait passer une loi rendant illégale Radio Rock et s’apprête à faire intervenir la Marine.
Pour échapper à une arrestation, l’équipe pousse le bateau à fond ce qui fait exploser les moteurs et provoque une voie d’eau fatale.
La fin de Radio Rock est annoncé en direct par les DJ ce qui arrache des larmes aux auditeurs.
Carl secourt Bob qui s’apprête à mourir avec sa précieuse collection de disques…
Mais les DJ ont la délicieuse surprise de voir des dizaines d’embarcations surgir pour les secourir.
Même si Radio Rock a été coulé, la diffusion de la musique rock ‘n’ roll semble inarrétable, propageant l’œuvre des DJ pionniers…
En conclusion, malgré une idée de départ sympathique « Good morning England » déçoit par le grand vide qu’il recèle.
Curtis préfère en effet mettre en avant les acteurs déblatérant plutôt que la musique, reléguant en arrière plan des stars comme Jimi Hendrix, The who, Cream, Otis Redding ou The beach boys.
Le résultat est que son film aboutit à montrer une poignée de types d’une vulgarité et d’une laideur repoussantes ne parlant que de sexe pendant près de deux heures, reléguant les femmes dans des rôles de faire valoir dociles à leurs prouesses sexuelles.
Ceci ne correspond pas à la partie qui m’attire dans la musique rock, l’aspect défonce et débauche non stop aboutissant au néant faussement cool et rebelle.
Je ne pourrais donc que conseiller ce film inutile qu’aux plus nostalgiques de la musique des années 60, ce qui doit représenter un public des plus réduits à présent !







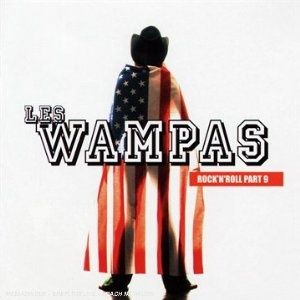









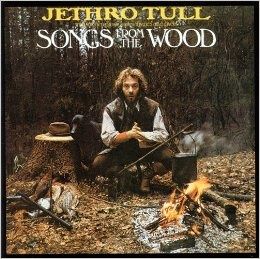

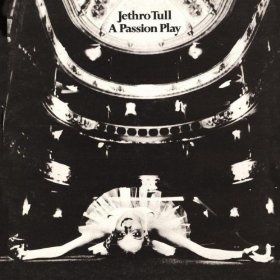



/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)