
Beaucoup dernièrement de musique dans ces colonnes avec une variété importante des courants du rock abordés, allant du hard rock classique des Scorpions au rock progressif intello de The Mars volta avec à présent un détour vers le goth-rock des britanniques de The sisters of mercy.
Après « Floodland » déjà chroniqué il y a trois ans, voici à présent le tour de « Vision thing » et sa pochette ésotérique sortis en 1990.
Entrée en matière impressionnante avec « Vision thing » marqué par une rythmique industrielle froide, le mur de guitare de Tim Bricheno/Andrea Bruhm et la voix rauque désincarnée d’Andrew Eldritch.
On pense bien évidemment à une version plus rock que métal de Ministry pour le coté dur mais efficace du style.
L’intensité chute alors sensiblement avec « Ribbons » certes moins puissant et démonstratif mais plus sombre, rampant et torturé.
On trouve un groupe un tantinet plus relax avec « Detonation boulevard » sur lequel la fameuse choriste Maggie Reilly intervient afin d’adoucir un peu la rugosité d’Eldritch et « Something fast » propose un nouveau mariage vocal pour une belle ballade acoustique toute en souplesse et très réussie.
L’exploration sonore se poursuit avec « When you don’t see me » chef d’œuvre synthétisant toute la dimension épique et romantique de Sisters of mercy transpirant derrière ces structures froides et rigides.
Ceci donne le coup d’envoi à un succession de standards, l’accrocheur « Doctor jeep » bâti sur une rythmique intense et nerveuse puis « More » génial bijou noir de l’œuvre de Sœurs qui transporte véritablement l’auditeur dans un voyage musical puissant, sensuel et coloré avec cette fois le synthèse parfaite entre Eldritch et Reilly pour un résultat purement détonnant.
Sans même sans rendre compte, nous sommes déjà arrivé à la fin de l’album et une nouvelle splendide ballade, « I was wrong » vient nous cueillir en douceur pour un sommeil apaisé.
En conclusion, trop méconnu à mon gout surtout par rapport à son encombrant ainé « Floodland », « Vision thing » est un authentique bijoux noir montrant toute la qualité de composition de The sisters of mercy, groupe unique à mi chemin entre métal industriel et rock gothique.
Des hits bien entendus, nombreux composent la moitié de l’album avec en point d’orgue le chef d’œuvre « More » mais moins spectaculaires et tout aussi captivantes sont les magnifiques ballades toutes en émotion et en subtilité.
On se régale donc à son écoute en savourant le coté indéniablement culte de la formation qui fut pour moi une grande référence des années 80/90.
A découvrir ou à redécouvrir donc de toute urgence, avec un plaisir à vrai dire quasi intemporel comme pour tout ce qui concerne les grands chefs d’œuvre.












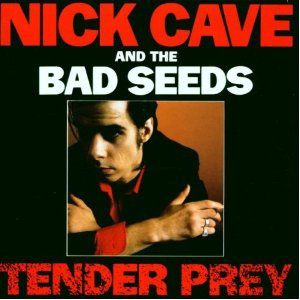


/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)