20 avril 2012
5
20
/04
/avril
/2012
11:51


Envie de découvrir plus en avant la riche discographie de Bernard Lavilliers.
Paru en 1981, « Nuit d’amour » et sa pochette digne des polars américains délaisse quelque peu les influences métissées et colorées du chanteur pour offrir un univers inspiré par
l’atmosphère nocturne et dangereuse des Etats-Unis.
Le titre introductif, « Night bird » s’appuie sur des rythmes électroniques froids pour dérouler une atmosphère sinueuse un brin déroutante ou le musculeux chanteur conte son obsession
amoureuse pour une femme de la nuit.
Malgré sa longueur et sa froideur, « Night bird » demeure intéressant par son approche littéraire et ses refrains aériens.
On bascule ensuite sur un beat pseudo reggae avec « Changement de main, changement de vilain » agréable et planant.
Le tempo ralentit ensuite avec « Eldorado » long morceau calme assez plat encore une fois influencé par le Brésil.
Lavilliers décide alors de réveiller l’auditeur un peu assoupi par « C’est du rock n’ roll » rock puissant et intense aux guitares hurlantes avant de réenclencher la musique à reggae
pour parler de manière décalée de « Pigalle la blanche ».
L’aspect poétique du chanteur se fait sentir avec « Betty » déclaration d’amour jouée en acoustique.
Tout est calme également avec « Nuit d’amour » au groove gentiment funky précédant le nouveau coup d’accélérateur de « Les barbares » reprise d’un morceau composé en 1976.
L’album se termine par « La malédiction du voyageur » épilogue un peu mou et pleurnichard à mon gout.
En conclusion, « Nuit d’amour » est un album solide hésitant entre ambiance urbaine nocturne ouest américaine et relents d‘influences jamaico-brésiliennes passés.
La présence de quelques titres forts (« Night bird », « C’est du rock n’ roll » voir « Changement de main, changement de vilain ») ne masque pas tout à fait un coté
global assez convenu dans le registre de l’aventurier poète conteur d’histoires.
En effet, Lavilliers cède parfois trop pour moi à ses penchants littéraires au détriment de l'intensité et de l'originalité de sa musique.
Pas déplaisant donc, mais pas transcendant non plus.
18 avril 2012
3
18
/04
/avril
/2012
19:02


Après le livre de Marcel Aymé, j’ai voulu logiquement visionner « La traversée de Paris » l’adaptation de Claude Autant-Lara parue en 1957.
Grand classique du cinéma français, « La traversée de Paris » raconte les mésaventures de Marcel Martin (Bourvil), chauffeur de taxi au chômage qui se livre au trafic de marché noir
pour survivre dans le Paris occupé de la Seconde guerre mondiale.
Privé de son associé habituel, Martin décide après une scène de ménage avec sa femme de proposer à un inconnu rencontré dans un bar de faire équipe avec lui pour convoyer 100 kilos de cochon à
pieds dans Paris.
Mais devant le propriétaire du cochon, un certain Jambier (Louis de Funès), l’associé du nom de Grandgil (Jean Gabin) se fait soudainement menaçant, exigeant de faire monter son salaire de
manière astronomique en exerçant un odieux chantage.
Soucieux de sa sécurité, Jambier finit par céder malgré les remontrance de Martin, excédé par le comportement de son partenaire d’un soir.
Les deux hommes se mettent donc en marche pour aller faire leur livraison jusqu’à Montmartre.
La traversée nocturne pendant le couvre feu est périlleuse.
Outre les brigades de policiers et les patrouilles allemandes, les deux hommes doivent se défaire de chiens attirés par l’odeur de viande et de français envieux prêt à les livrer aux
autorités.
Mais à chaque fois, la force et les intimidations de Grandgil leur permettent de se tirer d’embarras.
Après que celui ait assommé un policier trop curieux, le duo est obligé de se cacher chez Grandgil qui révèle à Martin qu’il est un artiste peintre plutôt coté qui s’est lancé dans cette aventure
au bluff par curiosité et gout du risque.
Martin est heurté dans sa fierté d’avoir été trompé et s’en prend violemment à Grandgil qui reste de toute façon physiquement le plus fort.
Lors de l’ultime étape de leur livraison, les nerfs de Matin lâchent et le raffut qu’il commet fait arrêter le duo.
Transféré chez les Allemands, Grandgil bénéficie d’un traitement de faveur en raison de son statut de peintre et évite d’être emmené dans un camion comme Martin.
Heureusement le film se conclut par un happy end après la libération, et par une retrouvaille impromptue entre les deux hommes.
En conclusion, « La traversée de Paris » est un solide film populaire brillant surtout par la qualité de ses acteurs exceptionnels.
Le film de Autant-Lara prend quelques libertés avec le livre de Marcel Aymé, notamment une fin moins sombre, puisque Martin ne tue pas Grandgil.
Dans ce grand numéro d’acteurs, Gabin se taille la place du lion en raison de son formidable abattage physique et de son coté gros dur.
Bourvil est parfait en français moyen plutôt lâche et faible, quand à Louis de Funès il débute déjà de manière convaincante dans l’un de ses tous premiers rôles.
Bien entendu, le film a fortement vieilli et fait son époque très franchouillarde, mais permet tout de même de passer un moment agréable.
17 avril 2012
2
17
/04
/avril
/2012
22:40


A la fin des années 90, certains grands noms du heavy metal traditionnel sans doute aiguillonnés par le succès des Nine Inch Nails, Marylin Manson, Ramstein, Fear Factory et autre White Zombie
vont se laisser tenter par l’expérience metal industriel et s’autoriser un détour par ce style alors en vogue.
Ce sera le cas de Rob Halford avec son éphémère projet parallèle « Two » mais également avec Alice Cooper qui sortira en 2000 « Brutal planet ».
A l'époque, ce nouvel album du chanteur fait figure d’évènement après six ans d’absence et une carrière vieillissante alors sur la pente déclinante.
Mais le vieux serpent effectue alors une nouvelle mue et s’entoure de quelques musiciens solides Bob Marlette (guitare, basse, claviers) gourou du genre, Eric Singer (batterie), puis
d’autres plus obscurs (China, Phil X, Ryan Roxie) forcément plus discrets pour s’atteler à son nouveau projet.
Pochette sombre pour univers futuriste sombre, « Brutal planet » débute avec un mid tempo rouleau compresseur sur lequel se superposent des vocaux terriblement accrocheurs.
Le son de guitare sous accordé si caractéristique du métal industriel creuse un sillon encore plus profond sur « Wicked young man » ou la voix rauque et désincarnée du chanteur sonne
plus puissamment que jamais.
Puis le tempo s’accélère subitement avec un « Sanctuary » terriblement revigorant avant de revenir à la plus pure expression du metal industriel incroyablement puissant et accrocheur
sur le mid tempo sombre « Blow me a kiss ».
Après ce début impeccable, les choses se gâtent un tantinet avec un « Eat some more » englué dans sa fange technoïde pour enchainer avec une superbe power ballade « Pick up the
bones » combinant parfaitement splendeurs ténébreuses et refrains déchirants.
Long et saccadé, « Pessi-mystic » a du mal à convaincre sur la durée malgré des passages calmes intéressant tandis que « Gimme » remplit efficacement son office de single en
puissance.
Plus légers, « It’s the little thing » et « Take it like a woman » délaissent momentanément l’industriel pour lorgner vers le rock traditionnel voir la ballade mielleuse pour
le second.
Alice termine par « Cold machines » plus en accord avec l’atmosphère générale du disque mais joué sans réelle conviction.
En conclusion, « Brutal planet » est une courageuse tentative seulement semi réussie.
Globalement grâce à quelques titres bien ficelés, la sauce prend et on a l’impression que le boa constrictor a revêtu une nouvelle peau métallique truffée de capteurs et d’actionneurs électriques
qui lui permet d’avancer dans de nouveaux terrains jusqu’alors inexplorés.
Mais d’autres fois le reptile alourdi par tout ce fatras technologique parait emprunté et ramper en agonisant sur le sol.
Au final, la mue laisse un gout d’inachevé comme si la créature hybride ainsi crée ne passait que difficilement le stade de la curiosité.
On saluera néanmoins l’audace du chanteur de se lancer dans pareille aventure après 30 ans de carrière.
14 avril 2012
6
14
/04
/avril
/2012
19:30


Si j’ai pu être un peu dur avec « Godsmack » le premier album des Bostoniens paru à la fin des années 90, ce relatif peu d’enthousiasme ne les pas empêché de se tailler une jolie petite
carrière commerciale au fin des ans.
Sorti en 2006, le bien nommé « IV » est le quatrième album de la formation qui a vu Shannon Larkin s’installer au poste de batteur occupé jusqu’alors par Tommy Stewart.
Avec sa pochette sobre vaguement ethnique, « IV » débute par « Livin in sin » excellent mid tempo gavé de puissance et de feeling.
Le groupe revêt ensuite son manteau de rockers durs à cuir avec « Speak » et « The ennemy » beaucoup plus massifs et rugueux.
Il faut attendre les titres suivants, « Shine down » mais surtout la superbe ballade planante « Hollow » pour sentir à nouveau une approche mélodique plus accrocheuse
grâce notamment à la voix rauque et chaude de Sully Erna.
Sans être exceptionnel, « No rest for the wicked » reprend la marche en avant chaloupée et métallique de Godsmack même si la suite symbolisée par « Bleeding me » se montre
particulièrement terne.
Les américains font alors un petit clin d’œil à une des réussites de leur premier album avec « Voodoo too » qui parvient pratiquement à égaler la magie noire du premier volet.
Sans surprise, « Temptation » donne dans le métal viril efficace mais est surclassé par « Mama » qui combine harmonieusement puissance et mélodie.
L’album se termine assez glorieusement avec « One raining day » superbe ballade de plus de sept minutes suintant le doux spleen.
En conclusion, assurément Godsmack s’est amélioré au fil des ans et a considérablement amélioré.
Sa musique est toujours très puissante et virile mais incorpore davantage d’ingrédients mélodiques pour faire huiler la mécanique et faire passer plus efficacement le couple moteur.
Bien sur, le groupe est parfois encore pataud ou relativement peu inspiré mais sa mixture mi grunge mi métal fonctionne au final avec une réussite tout à fait notable, faisant de Godsmack une
valeur sure du métal contemporain.
Published by Seth
-
dans
Hard Rock
Godsmack
IV
14 avril 2012
6
14
/04
/avril
/2012
18:46


Petit groupe américain underground des années 80, Melvins voit un regain d’activité et de notoriété à sa carrière lorsque Kurt Cobain, le leader de Nirvana, lui fait une pub d’enfer au début des
années 90, ce qui lui permet de décrocher un contrat chez Atlantic records.
Le chanteur-guitariste Buzz Osborne saisit alors l’occasion et sort un nouvel album en 1993 « Houdini » avec la bassiste Lori Black et le batteur Dale Crover.
Avec sa pochette faussement naïve, « Houdini » débute avec « Hooch » qui donne tout de suite le ton : son de guitare lourd et épais, tempo statiques et voix métallique
suintant la rage sourde.
Sombre, enfumé et torturé comme un film d’épouvante de série B, « Night goat » n’apporte rien d’autre qu’un climat malsain s’étalant en longueur.
Un peu moins linéaire, « Lizzy » alterne passages appuyés et plus calmes avant que le « Goin blind » de Kiss soit passé à la moulinette du sludge pour s’embourber en
beauté.
Le ton se fait plus rapide et agressif sur « Honey bucket » avant de replonger allégrement dans une atmosphère de sombre menace sur le long et ténébreux « Hag me ».
Un léger effort de groove est fait sur le court et tonique « Set me straight » qui en viendrait presque à sonner comme du Nirvana.
Après le semi instrumental « Sky pup » décousu, les Melvins semblent se réveiller avec « Joan of Arc » très puissant avant de retomber dans leur léthargie sur
« Teet ».
La jolie démonstration de guitare sur « Copache » est ensuite vite annulée par l’irritant tic tac de l’irritant semi instrumental « Pear bomb ».
« Spread eagle beagle » le dernier morceau de l’album est un atroce instrumental de 10 minutes rempli de vide.
En conclusion, « Houdini » permet bien de se faire une idée du style de musique des Melvins, ce rock lourd, gras, poisseux comme une journée de canicule dans le métro parisien, dont les
rythmes lents et répétitifs sont brièvement émaillés de courts éclairs énergétiques.
La voix dure et métallique de Osborne colle il est vrai parfaitement bien à ce style mais le résultat se montre au final terriblement ennuyeux en raison de l’absence de variations.
Le manque de vivacité, de feeling ou de mélodie caractérisent le son des Melvins qui sur la fin du disque lorgnent vers le foutage de gueule avec des instrumentaux particulièrement vides.
Bizarre, anti accrocheur et commercial, « Houdini » se planta complètement et provoqua l’éviction des américains de leur maison de disque.
Pour moi donc, Melvins est et restera un groupe underground.
Published by Seth
-
dans
Doom
Houdini
Melvins
13 avril 2012
5
13
/04
/avril
/2012
21:34
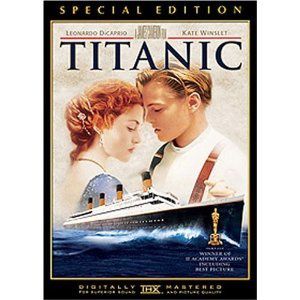

Aussi fou que cela puisse paraitre je n’avais jamais vu autre chose que des bribes du fameux « Titanic » de James Cameron.
On peut y voir un certain esprit de rébellion contre ce film multi oscarisé qui resta longtemps comme le plus gros succès de l’histoire au box office avant d’être détrôné par un autre film de
James Cameron « Avatar ».
J’ai en effet du mal à lire ou aller voir les best sellers mais essaie néanmoins de me soigner.
Sorti originellement en 1997 puis ressorti en 2012 pour profiter de l’avancée technologique du 3D, « Titanic » se présente comme une reconstitution romancée du naufrage du célèbre
paquebot de luxe qui fit naufrage en 1912 lors de sa première traversée Angleterre-Etats Unis et qui couta la vie à 1500 personnes.
Assez habilement, Cameron tisse une histoire d’amour autour de ce drame historique en racontant l’histoire de Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet) qui à plus de 90 ans se retrouve à livrer ses
souvenirs de rescapée à une équipe américano-russe à la recherche des trésors engloutis du paquebot.
A l’époque, jeune femme, Rose était une noble désargentée regagnant les Etats Unis avec son richissime fiancé Caledon Hockley (Billy Zane) pour effectuer un mariage d’intérêt.
Malgré un physique avenant, Hockley se montre comme un personnage antipathique, dur et machiste avec sa Rose dont le caractère indépendant souffre de la situation.
Alors que la jeune femme désespérée s’apprête à se jeter par-dessus bord pour mettre fin à ses tourments, un jeune homme Jack Dawson (Leonard Di Caprio) lui sauve la vie.
Jeune et intrépide, Dawson est un passager pauvre (de 3iéme classe) et s’est embarqué avec deux amis à l’aventure après une bref vie de peintre à Paris.
Un charme opère bien vite entre les jeunes gens, malgré la différence de classe et l’hostilité du futur mari.
Dawson entraine Rose dans un monde de charme, d’aventures loin des ennuyeuses conventions des riches passagers.
Les deux jeunes gens tombent amoureux et font l’amour malgré la vigilance du domestique de Hockley les traquant dans les immenses recoins du navire.
Fou de rage, Hockley fait accuser son rival du vol d’un superbe diamant ayant appartenu à Louis XVI, le cœur des océans.
Dawson est donc bouclé sous le pont en attendant son jugement mais un drame inattendu va bouleverser le déroulement des opérations.
Le monstrueux paquebot réputé insubmersible et dont la puissance fait la fierté de son concepteur l’ingénieur Thomas Andrews (Victor Garber) percute une nuit un iceberg et endommage sa coque.
Rapidement l’eau envahit les compartiments et la situation se dégrade.
Le commandant Edward John Smith (Bernard Hill) comprend très vite que la situation va rapidement devenir désespérée d’autant plus qu’il n’y sait qu’il n’y a pas assez de chaloupe pour tous les
passagers.
Commence alors l’effroyable naufrage avec un sentiment de panique générale allant en croissant.
Les passagers sont évacués en premier mais peu à peu les troubles éclatent notamment parmi les passagers de 3iéme classe enfermés sous le pont par des grilles en attendant que les classes
supérieures évacuent.
Oubliant sa peur et les menaces de son mari égoïste et lâche, Rose brave tous les dangers d’un bateau prenant l’eau pour retrouver et libérer le pauvre Jack.
Les deux amant parviennent à se retrouver mais le Titanic se fend en deux, provoquant alors la fin irrémédiable tant redoutée.
Jack permet à Rose de survivre dans l’océan glacé et se sacrifie pour la mettre hors de portée du froid.
La jeune femme ne doit son salut qu’à un seul canot de rescapé revenu chercher des survivants.
Le film se clôt sur ce récit émouvant et sur l’acte de la vieille femme ému de jeter le diamant qu’elle avait gardé jusqu’alors par-dessus bord.
En conclusion, « Titanic » est une grande fresque d’époque reconstituant minutieusement un acte dramatique qui marqua l’histoire.
L’ambiance de la traversée sur un paquebot à vapeur du début du XX iéme siècle est à vrai dire assez prenante et ce en raison de la qualité du jeu des acteurs, même si pour être franc le charme
de boys band de Di Caprio et la beauté anglaise de Kate Winslet me laissent complètement froid.
Puis la tension s’installe progressivement au fur et à mesure de la progression du sinistre pour aboutir à des situations véritablement effrayante rappelant le 11 Septembre ou plus près de nous
le naufrage du Concordia en Italie.
L’horreur est en effet bel et bien présente et vient se superposer à l’exaltation romantique de cet amour impossible.
Le succès du film tient donc pour moi surtout à la force de cette histoire d’amour à la Roméo et Juliette marquée par le sacrifice des amants.
Outre par beauté visuelle et son sens de la reconstitution, « Titanic » toucha donc de manière universelle les sentiments humains rêvant d’amour absolu, irraisonné, pur et faisant fi de
tous les obstacles.
De manière plus dépassionnée, on peut également y voir un témoignage de la folie des hommes, espérant avec orgueil que la technologie les mettrait à l’abri des forces de la nature.
Vous l’aurez compris « Titanic » n’est pas mon James Cameron favori mais il demeure à voir une fois dans sa vie et à mon sens plus intéressant sur le fond que le surgonflé
« Avatar ».
13 avril 2012
5
13
/04
/avril
/2012
20:43


Ne désespérant pas de trouver enfin mon bonheur dans la filmographie complexe de Jean-Pierre Melville j’ai finalement visionné « Le samouraï ».
Sorti en 1967, ce célèbre polar raconte l’itinéraire de Jeff Costello (Alain Delon) jeune et mystérieux tueur professionnel qui élimine pour un contrat un patron de boite de nuit.
Costello apparait comme un professionnel très bien organisé, froid, dur et maitre de lui jusqu’à l’impassibilité.
Mais si il parvient grâce à un faux témoignage de sa maitresse Jane Lagrange (Nathalie Delon) et à un surprenant revirement d’une pianiste Valérie (Cathy Rosier) à échapper à l’interrogatoire du
commissaire (François Perrier) , Costello rencontre tout de même des difficultés lorsque son commanditaire Wiener (Michel Boisrond) essaie de l’éliminer sur un pont.
Costello parvient à s’échapper mais est blessé au bras.
Il s’aperçoit qu’il est alors traqué à la fois par ses commanditaires et à la fois par les policiers qui ont réussi par chantage à faire craquer Nathalie.
Il réagit néanmoins en fauve blessé et cherche à remonter la piste de ses tueurs en faisant notamment parler Wiener venu une nouvelle fois l’éliminer.
Costello se rapproche également de Valérie pour qui il éprouve une mystérieuse et puissante attirance.
La pianiste semble jouer un double jeu étrange qui se confirme lorsque Costello découvre qu’elle habite chez son commanditaire.
Après avoir échappé à la police au cours d’une course poursuite effrénée dans le XX ieme arrondissement de Paris, Costello élimine son commanditaire et comprend que sa dernière cible est
Valérie.
Il se rend donc une nouvelle fois dans la boite de jazz mais se fait tuer par la police au moment de tirer sur sa victime.
Une fois Costello mort, la police s’aperçoit que son arme était déchargée ce qui ouvre beaucoup d’hypothèses sur ses réelles motivations.
En conclusion, « Le samouraï » est pour moi de loin le meilleur film de Jean-Pierre Melville.
L’action n’est certes toujours pas formidablement rythmée mais le climat de tension sous jacente et l’esthétique grise délavée du film le rendent particulièrement intéressant.
Les acteurs sont tous ici fantastiques mais aucun d’entre eux ne peut rivaliser avec la présence et la beauté énigmatique, glacée et puissante d’Alain Delon.
Avec « Le samouraï » Melville gomme les lourdeurs et les clichés de ses films (amitiés viriles, femmes faciles) pour réaliser une fascinante épure stylisée du film policier.
Solitaire, impavide, fier et maitre de son art, son tueur agit par instinct avec une maitrise de lui toute asiatique.
Très ouverte, la fin du film offre de multiples interprétations, la mienne étant que Costello sait sa position sans issue et préfère mourir son arme à la main en une sorte de suicide rituel
Seppuku de l’homme d’honneur s’apprêtant à faillir à sa mission soit par lassitude soir en raison des sentiments cachés éprouvés pour sa victime, ce qui peut être ici assimilé à de la faiblesse
voir une faute impardonnable.
« Le samouraï » est donc une vraie réussite et créa donc un rôle mythique pour Alain Delon alors au sommet de son art minimaliste.
9 avril 2012
1
09
/04
/avril
/2012
21:31
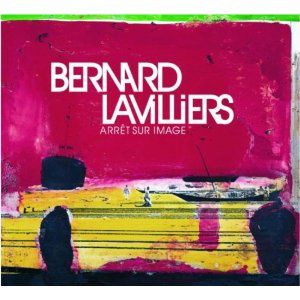

Les habitués de ce blog seront sans doute surpris de découvrir une chronique d’un album de Bernard Lavilliers en ces colonnes.
Pourtant même sans être un fan de sa musique, l’homme ne m’a à vrai dire jamais laissé indifférent.
Aussi est-ce avec un grand esprit de découverte que j’ai écouté son dix septième album « Arrêt sur image » sorti en 2001.
Avec sa belle pochette colorée comme une invitation au voyage maritime, « Arrêt sur image » débute par « L’or des fous » rendu élégant et très mélancolique par l’emploi
d’un accordéon et d’un violon.
La voix est posée, charismatique, les textes comme souvent impeccables et la coloration musicale assurément sud américaine.
Cette coloration se confirme avec « Iracema » très belle déclaration d’amour à une brésilienne inconnue du Nordeste.
Le rythme est lent, nonchalant, sensuel comme le balancement d’une belle brune sur un hamac par un après midi écrasé de soleil au bord de la mer.
Retour à une veine plus réaliste et politique avec « Les mains d’or » rendant hommages aux ouvriers de la sidérurgie.
On notera le remarquable travail de Marco Papazian dont le son de guitare clair et lumineux porte cette chanson lancinante du début à la fin.
Malgré son ambiance hypnotique et poétique, « Fleur pourpre » est rendu plus pénible en raison de son chant mollasson et de l’emploi de synthétiseurs décalés.
Nouvel hommage au Brésil avec « Saudade » douce ode à ce sentiment mélancolique inspirateur de bien des créations artistiques.
« L’empire du milieu » brille par la qualité des textes décrivant une nostalgie pour le passé de voyou du chanteur, par sa puissance contenue et par un son de guitare proprement
prodigieux.
Dans la même veine, on notera « Délinquance » surprenant de tolérance à l’égard des voyous de banlieue dans lequel le chanteur se reconnait surement.
Mais à vrai dire le morceau recèle une ambiance trop relax par rapport à la violence du sujet traité.
Lavilliers s’en prend ensuite avec talent aux hommes d’affaires de ce monde avec « Les tricheurs » agrémenté de bruitages électroniques des plus étranges.
Chanté à moitié en anglais avec une chanteuse américaine envahissante, « Octobre à New-York » a moins d’impact.
Lavilliers se surpasse sur « La dernière femme » merveilleuse déclaration d’amour au texte ciselé et à la mélodie sublime grimpant progressivement en puissance.
La fin de l’album se profile donc avec « Solidaritude » un peu tristounet et par une version cubaine très vivante de « Les feuilles mortes » de Jacques Prévert.
En conclusion, pour une découverte, « Arrêt sur image » s’est avéré une formidable expérience.
La voix de Bernard Lavilliers est plaisante, ses textes sont superbes, pétris d’intelligence, de poésie et de rébellion.
Bien entendu le ton est plutôt calme, relax, intimiste et n’a absolument rien à voir avec les déchainements de décibels dont je fais ici souvent l’éloge mais le son de guitare de Papazian clair
et puissant est un véritable régal.
On peut donc imaginer déguster « Arrêt sur image » seul dans une chambre d’hôtel dans un silence absolu pour virer à la plus totale introspection ou alors dans une ambiance de vacances
au bord d’une mer chaude.
Un album mature et digne d’un grand cru de la chanson française.
9 avril 2012
1
09
/04
/avril
/2012
20:07


FFF était un groupe de rock français qui brilla pendant une décennie (1991-2000) avant de disparaitre de la circulation.
Mélangeant rock et funk en une fusion énergique, FFF se tailla une jolie réputation dans l’Hexagone, en raison de ses prestations scéniques explosives et de la personnalité attachante de son
leader le chanteur d’origine béninoise Marco Prince.
Le troisième album sobrement intitulé « FFF » sort en 1996.
Le premier morceau « On ne badine pas avec la mort » assez calme, brille surtout par les variations vocales de Prince, les envolées guitaristiques de Yarol Poupaud et par un texte assez
sérieux sur le Sida.
L’ambiance est beaucoup plus électrique sur « Barbès » excellente fusion énergétique rendant hommage à ce quartier populaire et coloré de Paris.
Dans la même veine, « Mauvais garçon » s’avère plus laborieux avec une style très reggae et des refrains particulièrement faibles mais ce petit écart est vite gommé par l’excellent
« Le pire et le meilleur » qui fait la part belle à un rock puissant parfaitement maitrisé.
Arrive ensuite la perle du disque, une surprenante power ballade éthérée aux textes d’une beauté poétique exceptionnelle « Morphée ».
Pour faire baisser la tension, les doux « Act up » chanté à moitié en anglais et « Le muscle magique » assez humoristique viennent apporter une accalmie à cette tornade
de fusion.
FFF replace alors sa fusion funk-rock nerveuse avec « Niggalize it » une nouvelle fois influencé par l’anglais.
La fin de l’album s’effectue en pente douce avec « Un jour » ballade curieusement intimiste sur le retour aux origines, « Laisser aller » mollasson et dépressif avant
« Knock you down » un ultime uppercut power funk administré dans les règles de l’art.
En conclusion, « FFF » est un album de qualité dans la droite lignée des productions de fusion à la mode durant la fin des années 90.
Avec son énergie, la verve et la fraicheur de son chanteur, FFF tire honnêtement son épingle du jeu et propose un album agréable comportant quelques titres accrocheurs (« Barbés »,
« Le pire et le meilleur ») un hors classe « Morphée » avant de connaitre une deuxième partie un poil plus laborieuse.
Mention honorable donc pour cette fusion made in french.
Published by Seth
-
dans
Fusion
Rock
FFF
9 avril 2012
1
09
/04
/avril
/2012
09:19
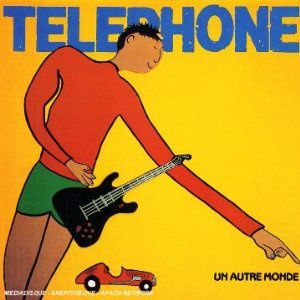

Aucun français ou résident français n’a pu je le crois échapper dans sa vie à l’écoute du groupe Téléphone ne serait ce que par les innombrables rediffusions de ses plus grands succès radio.
Malgré la brièveté de sa carrière (8 ans seulement !), Téléphone a en effet marqué de sa patte le rock français et peut assurément briguer la place de numéro d’un genre il est vrai ou les
concurrents sont des plus clairsemés.
Sorti en 1984, « Un autre monde » et sa pochette débilo-infantile est le dernier album d’un groupe alors en plein succès mais dévoré par les conflits intérieurs entre le
chanteur/guitariste Jean-Louis Aubert principal compositeur du groupe, Louis Bertignac talentueux guitariste principal, Corinne Mariennau (bassiste) et Richard Kolinka (batteur).
On débute en douceur avec « Les dunes » qui pendant quatre minutes ne parvient à décoller.
La suite est d’un meilleur acabit et les parisiens alignent un de leurs mémorables tubes, « New York avec toi » , influencé par une veine rock n’ roll old school.
Comptant l’attraction et les fantasmes pour la ville reine des USA, « New York avec toi » et son court format sympathique font mouche.
Après un « Loin de toi » qui balance bien arrive « 66 heures » beaucoup plus rapide et dynamique tout en gardant une veine rock bien sentie.
L’intensité est toujours de mise sur « Ce que je veux » simple et direct mais c’est réellement « La garçon d’ascenseur » prodigieux en terme de riffs et d’énergie dégagée qui
impressionne.
Téléphone intercale ensuite le court et rapide « T’a que ces mots » également brillant par la qualité de ses riffs entre deux titres plus calme et réconfortant « Oublie ça »
« Le Taxi la ».
L’album se termine avec « Electric cité » très groovant et par sans nul doute le plus grand tube de l’histoire du groupe, « Un autre monde » si multi diffusé les trente
dernières années par toutes les radios de France qu’il semble maintenant faire partie du paysage sans qu’on y prenne plus trop garde.
En conclusion, pour un départ, « Un autre monde » termine formidablement bien la carrière d’un groupe réputé mythique pour le rock français.
Même si la voix cassée de Jean-Louis Aubert et son coté grand frère réconfortant m’irrite par instant, force est de constater que « Un autre monde » est excellent album reposant sur des
compositions efficaces, intelligemment travaillées, habitées par l’excellent jeu de guitare de Bertignac et par une énergie positive souvent emballante.
Téléphone sonne certes aujourd’hui daté, mais la qualité de ses compositions reste et restera encore pendant longtemps.
Published by Seth
-
dans
Rock
Telephone
Unautremonde

![]()








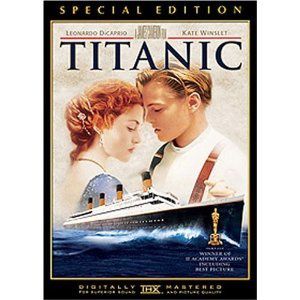

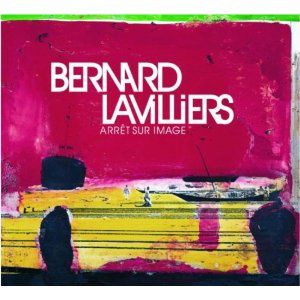

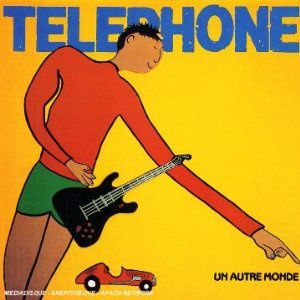
/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)