
![]()
Nous restons dans le royaume des groupes tristes avec « Disintegration » de The cure.
Sorti en 1989, cet album à la pochette goth-rock montant le visage sur maquillé de Robert Smith, marque la fin des années 80 dites dorée pour le groupe anglais qui bâti l’essentiel de son
considérable succès durant (duran) cette période.
L’entame se fait en pente douce avec « Plainsoning » long titre majoritairement instrumental déroulant une ambiance calme et enveloppante.
Plus de sept minutes au compteur pour « Pictures of you » mais de pur charme autour de ce morceau soignée irradiée d’une belle aura de tristesse lumineuse charriée par la voix
toujours magique de Smith.
On reste dans le même type d’ambiance avec « Closedown » ou l’on retient surtout le doux mélange entre les claviers caressant de Roger O’Donnell/Porl Thomson et les guitares
bridées soigneusement de Thomson/Smith
Par la suite, « Love song » contient un coté plus pop année 80 nettement plus marqué et disons le franchement il est difficile de ne pas sentir un lent engourdissement à l’écoute de
« Last dance » bien trop statique et mollasson.
The cure se souvient néanmoins qu’il est aussi un groupe de hits et place « Lullaby » dont la mélodie sophistiquée aidée de violons, l’ambiance de cauchemar rampant et le clip
hallucinant ou le chanteur se faisait lentement dévorer par une araignée géante, octroyèrent un passage sur les radio et les chaines de télévision dites généralistes.
On revient ensuite au style standard du disque avec « Fascination street » qui après une première partie instrumental longuette, finit par s’animer un peu dans son dernier tiers,
« Prayers for rain » long et majestueux atmosphérique tout en infimes nuances avant que le groupe ne se surpasse avec « The same deep water as you » et ses neuf minutes de
ténébreux statisme absolu.
L’auditeur un peu usé et anesthésié se prend alors à accélérer pour déboucher sur la fin du disque qui disons le tout de go, tarde à arriver.
En guise de tirade finale, The cure place « Disintegration » long titre à tiroirs s’enroulant sur lui-même sur plus de huit minutes, « Homesick » qui dépasse allégrement les
sept minutes dont une majorité instrumentales et comble du comble un titre sans nom qui s’étale malgré tout sur plus de six minutes copieusement pénibles.
En conclusion, malgré quelques jolies pépites placèes dans sa première partie, « Disintegration » est un album sophistiqué jusqu’à la préciosité et rendu pratiquement inécoutable en
raison de sa longueur excessive.
La quasi-totalité des titre dépassent les quatre minutes et les trois quart oscillent entre six et neuf minutes au compteur, ce qui compte tenue de leur ambiance cérébrale et intimiste, conduit
inévitablement à terme à un puissant sentiment d’endormissement.
The cure se détache de son coté pop/rock accessible et s’enlise dans son rock éthéré, langoureux et mélancolique qui finit par user l’attention d’un auditeur habitué à plus d’énergie et de
mouvement.
A réserver aux fans de musique sophistiquée, douce, sombre et instrumentale, les autres pourront allégrement passer leur chemin.










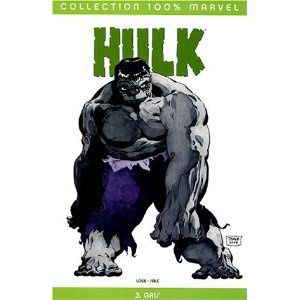

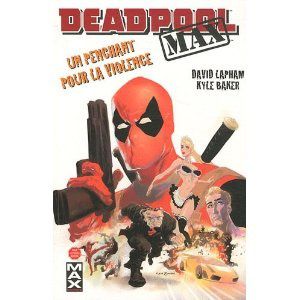
/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)