2 août 2011
2
02
/08
/août
/2011
18:04
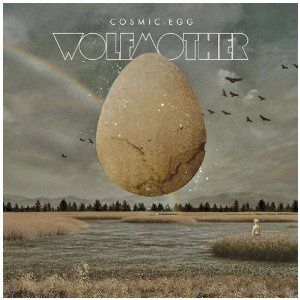

Trois ans après un premier album fort convaincant, un Wolfmother totalement remanié remet le couvert en 2009 avec le très attendu « Cosmic egg » à la pochette ovoïde qui plaira aux
amateurs de science fiction.
Privé de son bassiste et de son batteur, Andrew Stockdale remanie complètement son groupe, embauche Ian Perez (basse/claviers) et Dave Atkins (batterie) puis se renforce d’un autre guitariste
Aidan Nemeth pour le seconder.
Ce bel œuf cosmique débute de la meilleure manière avec « California queen » titre vif et accrocheur parsemé de belles cassures rythmiques évoquant la pesanteur du rock lourd des années
70.
Cette mise en bouche est suivie de « New moon rising » , véritable merveille de rock énergique, intense et lumineux doté d’un groove phénoménal.
Moins marquant est « White Feather » car oscillant entre pop et rock plus soutenu.
On revient à une inspiration plus Sabbathienne avec tintement de cloches à la Stooges sur le redoutable « Sundial » avant de basculer sur la douce et belle ballade « In the
morning ».
Le hard des années 70 est magnifié sur le stratosphérique « 10 000 feet » .
On côtoie aussi la cours des grands sur « Cosmic egg » avec ses rythmiques irrésistibles et ses vocalises incandescentes.
Wolfmother aligne une deuxième ballade, « Far away » un peu trop pop sucrée à mon gout avant de rejouer la carte rock 70’s sur le mélodique « Pilgrim » agrémenté de
clochettes.
Sur « In the castle » le groupe reprend de la vitesse, réenclenche sa presse à groove et se fait de nouveau irrésistible.
Le clavier de Perez est à l’honneur sur le biscornu « Phoenix » avant le final en forme de superbe ballade éthérée « Violence of the sun ».
En conclusion, un peu moins monolithique et débridé que le premier album qui était un véritable catalogue de riffs tueurs du hard des années 70, « Cosmic egg » marque une évolution vers
un léger adoucissement dans la musique de Wolfmother.
Cette évolution se caractérise par plus de ballades pop mais le socle de la musique des australiens reste le même, le hard rock des années 70 et « Cosmic egg » contient toujours
de grands moments rendant magnifiquement hommage à cette époque bénie de la musique.
Essai confirmé donc pour ma part avec cette album brillant et de haute tenue qui ravira les amoureux du rock à l’ancienne.
Pour moi Wolfmother constitue donc toujours le haut du panier du rock actuel.
1 août 2011
1
01
/08
/août
/2011
21:06
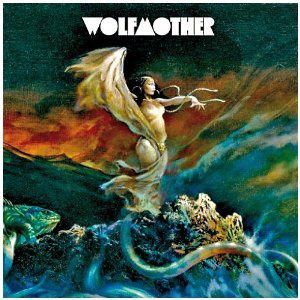

Pour changer des vieux groupes de dinosaures du hard rock, voici un petit coup de jeune avec Wolfmother jeune groupe australien ayant sorti son premier album « Wolfmother » en 2006.
Wolfmother est un trio audacieux composé de Andrew Stockdale au chant/guitare, un grand escogriffe jugé sexy par ces dames, Chriss Ross à la basse/orgue et Myles Heskette à la batterie.
Wolfmother ou plus exactement comment faire du neuf avec du vieux et recycler (avec un talent fou) la musique des dieux des années 70, Black sabbath et Led zeppelin entre autres.
La pochette, superbe illustration d’(h)ero(t)ic fantasy illustrée par cette légende de Frank Farzetta, augurant du meilleur aussi est-ce avec empressement qu’on se cale « Dimension »
entre les deux oreilles.
Le timbre de voix nasillard mais agréable de Stockdale à la Ozzy Osbourne frappe tout de suite et on est happé par cette fusion heavy et rock, rendant abordable la lourdeur originelle d’un Black
Sabbath.
Le phénomène est amplifié avec « White unicorn » qui propose un surprenant voyage dans le temps directement dans la magie des années 70.
Cette musique lourde mais également énergique et festive donne une incoercible envie de bouger, de crier et de s’éclater.
Ces vibrations bénéfiques apparaissent sur l‘intense pilonnement de « Woman » dont les délires intenses à l’orgue rappellent fugacement les Doors.
Mais la mère du loup sait aussi se faire tendre avec la ballade « Where eagles have been » aux sonorités plus actuelles évoquant un croisement des White Stripes et de Led
Zeppelin.
L’influence des White stripes se fait alors de plus en plus grandissante que ce soit sur le néo punk« Apple tree » ou sur le rock nerveux de « Joker and the thief » .
Puis Wolfmother enclenche à nouveau la machine à remonter le temps et revient à ses premiers amours sabbathiens sur le monstrueux « Colossal » aux rythmiques écrasantes de cette
lourdeur divine.
Après cette pure giclée de lumière noire, on reprend ses esprits avec le plus calme « Mind’s eye » doté d’un clavier vintage omniprésent illuminant de grande envolées vocales.
Grosses rythmiques et claviers excentriques marquent les esprits sur « Pyramid » d’une insolente créativité.
Au bout d’une dixième titre, les forçats australiens lèvent enfin le pied avec le plus poussif « Witchcraft » qui recèle tout de même la particularité d’utiliser une flute.
Alors qu’on s’attend à un logique déclin, Wolfmother se reprend immédiatement avec l’excellente et moderne power ballade « Tales » débordante de classe puis sur « Love train »
aux formidables riffs accrocheurs et festifs.
On termine ce festin de roi par une sympathique ballade acoustique « Vagabond ».
En conclusion, « Wolfmother » est la stupéfaction absolue, l’uppercut au menton, le crochet au foi qui troue votre garde, et vous laisse sonné, abasourdi par le résultat forcément
inattendu.
On se demande par quel miracle ces jeunes chercheurs australiens ont réussi ce clonage improbable entre le heavy metal des années 70 que je vénère (celui de Black Sabbath) , les quelques touches
rock des Doors et le rock moderne des White Stripes, mais toujours est il que le résultat dépasse les espoirs des scientifiques les plus fous.
Véritable carton commercial, « Wolfmother » montra que le rock des ancêtres peut encore être populaire à la fin des années 2000.
Les esprits chagrins pourront sans doute souligner le manque de personnalité du groupe qui puise dans diverses et prestigieuses influences, mais ceci est fait pour moi avec tellement de talent et
d’a propos qu’il serait idiot de bouder son plaisir.
« Wolfmother » ou l’album idéal pour s’éclater en écoutant du rock des années 70 sans passer pour un ringard !
Published by Seth
-
dans
Hard Rock
Wolfmother
1 août 2011
1
01
/08
/août
/2011
20:02


Un an seulement après « In trance » les très prolifiques Scorpions sortent 1976 « Virgin killer » au titre très marquant mais à la pochette dénudée flirtant avec la
pédophilie.
A l'époque, le groupe se déchargea assez hypocritement sur la maison de disque mais il faut reconnaitre que si la violation du tabou et un certain (mauvais) gout pour la provocation cadre assez
bien avec l’image du hard rock, le fait de repousser ce type de limites ne colle pas parfaitement avec un groupe aussi mainstream que les Scorpions.
Toujours est il que cette (trop) jeune fille sur la pochette fit beaucoup pour la publicité des jeunes rockers allemands.
Et la musique dans tout çà ? Et bien, « Pictured life » se présente par son coté très dynamique et accrocheur comme le single perfoant idéal.
On retrouve immédiatement le coté spectaculaire des guitares de Michael Schenker et de Ulrich Roth sur « Catch your train » mais parfaitement canalisé par encore une fois un morceau aux
refrains rock and roll franchement emballants.
« In your park » la première ballade se dévoile, douce, romantique et subtile comme la caresse du vent sur la peau nue une nuit d’été.
Puis après ce départ en fanfare, tout s’étiole avec « Backstage queen » bien mollason malgré un titre prometteur puis sur « Virgin killer » au curieux rythme heurté sur
lequel vient s’échouer la voix éraillée d'un Klaus Meine au lendemain d'une cuite.
Encore pire « Hellcat » n’a ni queue ni tête et un coté expérimental très déroutant.
En réussite sur les ballades, les Scorpions instaurent une atmosphère originale et un sombre sur « Crying days ».
Le chant de Roth massacre « Polar nights » avant une ultime ballade que je trouve de trop car bien sirupeuse « Yellow raven ».
En conclusion, malgré un début en trombe sur les trois premiers titres laissant penser que « Virgin killer » allait être l’album majeur des Scorpions des années 70, la déception est une
nouvelle fois au rendez vous.
Bien que de moins blues et psychédéliques, les Scorpions ne sonnent toujours pas franchement hard et le style rock-mélodique de Roth qui de surcroit chante ici m’exaspère toujours sur la
durée.
Les ballades sont également très largement représentées ici, ce qui prouve que même avant d’exploser avec des ballades mémorables inondant les radios dans les années 80, les Allemands étaient
déjà adeptes de ce penchant particulier.
« Virgin killer », derrière ce titre et cette pochette chocs, rien que de bien ordinaire à mes yeux.
30 juillet 2011
6
30
/07
/juillet
/2011
16:48


Après les féroces Death angel, quelques envies de rock plus calme avec « In trance » des Scorpions.
Autant le dire tout de suite je ne suis pas et ne serais jamais fan de ce groupe mais ces dinosaures du hard rock aussi anciens que Judas priest méritent assurément un miminum de
considération.
Avec sa superbe pochette évoquant une Claudia Schiffer aux frontiéres de l'orgasme avec une guitare, « In trance » sort en 1975 après deux albums d’estime influencés par le rock
psychédélique, Rudy Lenners remplace Jurgen Rosenthal à la batterie, le chanteur Klaus Meine et les guitariste Rudolf Schenker/Uli Jon Roth formant toujours le noyau créatif du groupe.
On débute avec « Dark lady » mid tempo aux riffs accrocheurs rehaussées par quelques cris suraigus de Meine pour enchainer sur une ballade mélancolique « In trance » plutôt
réussie.
Le style très fin et mélodique de Roth imprègne fortement les compositions comme la ballade blues « Life’s like a river » dont le titre n’aurait pas été renié par le philosophe
Héraclite.
Tout ceci est bien beau, bien planant et un poil maniéré à l’image d’un « Top of the bill » qui ne parvient pas à accélérer franchement.
Les Scorpions nous assènent une autre ballade « Living and dying » une nouvelle fois bien comme il faut.
Le premier vrai titre rentre dedans est sans nul doute « Robot man » (le cousin d’Iron man de Black sabbath ?) qui déboule à toute vitesse sur un pur tempo hard rock mais l’embellie est
de courte durée puisque deux autres blues « Evening wind » et « Sun in my hand » viennent à nouveau nous chloroformer.
L’album se termine dans la même veine rock blues-psychédélique avec « Longing for fire » et l‘instrumental « Night lights » parfaits pour s’endormir tard la nuit.
En conclusion, « In trance » n’est pas un album pour votre serviteur.
Le style du groupe, très mélodique et blues, est certes respectable mais provoque chez moi un suprême ennui.
Tout est en place et bien exécuté, le toucher de Roth, la voix de Meine, mais manque singulièrement de saveur.
On aimerait être secoué, touché, bouleversé comme par le charme de quelqu’un qui n’est pas forcement physiquement beau mais qui demeure attirant par son imperfection et son charisme mais au lieu
de cela on trouve avec « In trance » un beau et froid mannequin de plastique à la beauté figée.
Et si les Scorpions des années 70 était un groupe plutôt surestimé ?
Published by Seth
-
dans
Hard Rock
Scorpions
Intrance
29 juillet 2011
5
29
/07
/juillet
/2011
20:34


Bien relancé par un « The art of dying » de bonne facture, Death angel poursuit en 2008 sa seconde carrière avec « Killing season » à la pochette similaire bien qu’un brin
plus morbide.
Après l’art de la mourir, la saison du massacre, on peut dire qu’avec Death angel on a affaire à un groupe dur et sombre qui ne fait pas dans la dentelle, avec une violence contrôlée comparable à
leurs confrères new yorkais d’Overkill.
« Lord of hate » ouvre les hostilités sans faire de détail avec un thrash percutant solidement ancré au sol par des refrains en béton armé.
Le son est lourd, presque gras, les guitares tournoient à la vitesse d’un rotor d’hélicoptère pour offrir sur « Sonic beatdown » une leçon de tabassage en règle duquel nul être vivant
ne pourrait se tirer indemne.
Un tantinet plus calme « Dethroned » alterne en réalité passages mélodiques en clair obscur et grosses charges d’un thrash implacable digne des plus grands.
Gros riffs et rythmiques assassines prennent la relève sur le très basique « Carnival justice » .
Certes « Buried alive » n’est pas un modèle de subtilité avec ses chœurs ultra pesants, mais fait preuve d’une efficacité de panzer.
« Souless » sonne comme du Ac/Dc en plus nerveux et rugueux tandis que « The noose » balance son thrash rageur comme un poing en pleine figure.
Les gros bras continuent leur travail de démolition avec les lourdingues « When worlds collide » et « God vs God » aux influences très Machine head.
Plus vif et percutant, « Steal the crown » fait des ravages avant le coup de grâce asséné par « Resurrection machine » mid tempo guerrier contrebalancé de quelques
fugaces envolées mélodiques.
En conclusion, plus frontal et intégriste que son prédécesseur « Killing season » est un authentique album de thrash metal monolithique, violent et moderne comme j'aime à écouter
parfois quand le monde me parait vraimment révoltant.
Avec ce durcissement de ton, Death angel se recentre sur sa base et rétrécit du même coup son champs musical, perdant la variété musicale si plaisante de « The art of dying ».
Mais le groupe assume son choix artistique et plonge avec force et conviction dans ce bain de jouvence en jouant à fond la carte de la puissance brute ou les guitares claquent comme fouets
mortels sur des tempos de rouleau compresseur.
Impressionnant et maitrisé de bout en bout, « Killing season » impose le respect et achève de nous convaincre que Death angel est un groupe de sacrés clients pouvant sans peine
prétendre au rang de maitres du thrash pur et dur.
29 juillet 2011
5
29
/07
/juillet
/2011
19:13


Zoom sur la deuxième division du thrash metal avec Death angel, groupe californien ayant la particularité d’être entièrement d’origine asiatique, philippine plus précisément.
Ayant eu son heure de gloire à la fin des années 80, Death angel profite du revival de la scène et refait surface à la surprise générale en 2004 après 14 ans de mise en sommeil.
Petit miracle, le line up original est ici conservé prêt de vingt ans après les débuts et cette reformation donne naissance à « The art of dying ».
On appréciera l’effort mis sur l’artwork de la pochette, à la fois sobre, sombre et beau.
La galette débute par « Thrown to the wolves » longue pièce de plus de sept minutes d’un thrash old school rentre dedans aux refrains très efficaces.
La voix nasillarde et rêche de Mark Osegueda se cale parfaitement sur les rythmiques saccadées et puissantes des guitares de la paire Aguilar/Cavestany sur « 5 steps to freedom » qui
compense une certaine linéarité par une intensité soutenue.
Alors qu‘avec « Thicker than blood » on s’apprête à rentrer dans une logique routinière et peu inspirée de thrash prévisible à outrance, l’ange de la mort surprend avec « The devil
incarnate » longue pièce reptilienne évoquant un climat de sorcellerie et de menace larvée digne d’un Black sabbath des meilleurs jours.
Véritable bijou noir, « The devil incarnate » me fait curieusement penser à des trajets que j’effectuais très tôt le matin en voiture sur des petites routes désertes de l’Essonne dans
un climat de brouillard fantomatique et de nuits hivernales en parfaite adéquation avec l’ambiance assez fantastique de ce titre.
On est également agréablement surpris par « Famine » aux forts relents de Metallica grungy période « Load-Reload ».
Retour à du thrash plus classique sur le basique « Prophecy » à la forte puissance de feu puis baisse de régime avec le laborieux punkoide « No » .
Les quelques variations mélodiques sur le chant de « Spirit » viennent diluer l’abrasive recette thrash habituelles des cuistots en chef.
Les refrains virils sur le très bourrin « Land of blood » contrastent avec un final plus calme composé de « Never me » qui mélange passages nuancés presque rock à des solides
refrains thrash puis « Word to the Wise » superbe semi ballade acoustique ou la belle voix cassée de Osegueda couplée à des guitares pleines de feeling, parvient à faire passer un flot
intense d’émotion.
En conclusion, « The art of dying » est une bonne surprise de vétérans d’une scène qu’on pensait oubliée à jamais.
Meme si la recette de base des américains est à la base beaucoup trop prévisible et linéaire à mes yeux, ceux-ci ont l’intelligence d’introduire d’étonnantes variations qui si elles ne
révolutionnent pas la face de la musique aèrent leur thrash frontal pour en relever l’intérêt.
« The art of dying » est un disque astucieux capable de réaccrocher les fans de thrash des années 80 mais aussi par sa relative ouverture de capter un public plus adepte d’une certaine
modernité.
Retour réussi donc pour Death angel qui recycle son bon vieux thrash pour faire du neuf avec du vieux.
27 juillet 2011
3
27
/07
/juillet
/2011
21:33


Exploration du punk rock avec après les Sex Pistols, l’autre légende anglaise de ce mouvement The Clash.
Sorti en 1999, « From here to eternity » est une compilation de titres joués entre 1978 et 1982 soit l’âge d’or du groupe.
On peut trouver l’idée curieuse, un brin mercantile mais on peut aussi prendre cela comme une bonne occasion de découvrir l’impact d’un des groupes les plus réputés sur scène de l’histoire du
rock.
La compilation commence avec « Complete control » titre truffé de chœurs plus rock que punk permettant de chauffer la salle en douceur.
Le coté plus agressif, braillard et bordélique du punk vient sur « London’s burning » puis sur le musclé « What’s my name » avec toujours des chœurs en soutien de la voix de
cockney de Joe Strummer.
C’est simple, énergique peut être un peu trop pauvre.
Si « Clash city rockers » se montre un morceau aux riffs rock entrainants, la formule commence à lasser avec « Carrer opportunities » vraiment trop balourd.
Pas grand intérêt pour moi avec le reggae « (White man) in hammersmith palais » ni le trop basique « Capital radio » ni « City of dead » aux riffs et aux refrains
bien faciles.
Les irréprochables classiques arrivent enfin avec l‘hymne « I fought the law » puis « London calling » et son atmosphère plus mesurée si particulière.
Je ne peux que décrocher sur le pur reggae « Armagideon time » non pas que le morceau soit mauvais dans l’absolu mais parce que ce style de musique trop planant ne me convient pas.
On passe sur l’insipide « Train in vain » que ne parvient pas à relever le très surestimé « Guns of Brixton ».
Il faut attendre « The magnificent seven » au rythme funkisant et le plus appuyé « Know your rights » qui malgré un message politique assommant, parviennent à réintroduire
plus d’intensité.
Le plus grand tube des Clash « Should I stay of should I go » est asséné avec force avant de conclure par un trop long « Straight to hell » en forme de pénible
monologue.
En conclusion, vous l’aurez compris en lisant mes commentaires pour le moins contrastés, je n’adhère globalement pas à la musique de The Clash et ce live bien qu’exhaustif n’y changera rien.
Bien entendu j’aime quelques chansons d’eux mais relativement peu.
Je trouve leur punk pas assez instincintif, pas assez sauvage ni acéré, pas assez nihiliste et au final trop métissé avec des ambiances reggae et pop rock que je ne goute pas.
Le coté simpliste des riffs, la voix parfois irritante de Strummer et les refrains téléphonés ne me séduisent pas.
Je ne pense donc pas être la bonne cible pour ce « From here to eternity ».
Peut être me pencher sur leurs meilleurs albums studio changera-t-il l’opinion que j’ai de ce groupe trop mainstream pour moi.
27 juillet 2011
3
27
/07
/juillet
/2011
20:39
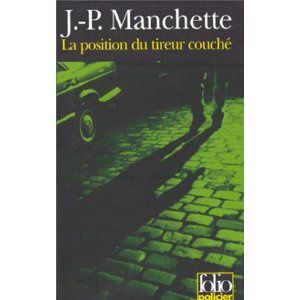

Roman policier avec « La position du tireur couché » de Jean-Patrick Manchette.
Un peu à l’instar de Joël Houssin dans un genre différent, Manchette appartient à cette génération d’auteurs de polars à la française, d'un genre viril qui faisait fureur au début des années 80
et qui furent souvent incarnés au cinéma par Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Lino Ventura dans des films de flics gros bras macho carburants aux gauloises et au whisky avant de faire tomber
les jolies filles une fois les voyous forcément en cheville avec des politiques ripoux mis hors d’état de nuire.
Court roman policier, « La position du tireur couché » narre de manière classique les aventures d’un tueur professionnel appelé Martin Terrier mystérieusement traqué alors qu’il vient
d’annoncer à son patron dénommé Monsieur Cox qu’il prenait sa retraite.
Cette traque un brin emberlificotée va nous emmener de Paris à … Paris après un bref détour dans un village du Sud ouest (Nauzac) ou notre antihéros tentait de renouer avec ses racines et son
amour de jeunesse Anne, remariée depuis avec un notable forcément pas à la hauteur du tempérament explosif de l’héroïne.
Bien entendu, le tueur traqué va s’avérer avoir de la ressource et être capable d’éliminer les tueurs lancé à ses trousses notamment Claudia Rossi, la sœur d’une de ses victimes italiennes.
Après un dernier contrat en forme de faux attentat destiné à l‘éliminer, Terrier (dont suprême cliché le meilleur ami est noir !) se retourne contre son ancien patron dans un final en forme de
feu d’artifice.
Mais la morale sera sauve et le tueur n'en sortira pas pour autant totalement indemne.
En conclusion, bien que relativement bien écrite, « La position du tireur couché » ne contient pas une intrigue suffisamment interessante pour me passionner.
Le personnage du tueur invincible à le froide efficacité mécanique ne peut pas pour moi générer de l’empathie et sa manière de traiter les femmes (notamment sa première petite amie Alex
assassinée par sa faute) a de quoi irriter.
Outre ce fond qui m’a déplu, on notera une efficacité d’écriture et une très grande dose de violence avec des meurtres dispensés à grande échelle dans une grande sauvagerie.
A réserver donc pour les fans (pas trop exigeants ) de polars français à l’ancienne.
27 juillet 2011
3
27
/07
/juillet
/2011
18:12


Voici avec « Aguirre la colère de Dieu » de Werner Herzog un film véritablement envoutant et fascinant.
Réalisé en 1972, cette oeuvre atypique raconte une expédition espagnole qui au XVI iéme siècle après Jésus Christ parcourt la jungle amazonienne du coté du Pérou pour trouver le mythique pays des
cités d’or appelé par les indiens Eldorado.
Mais embarrassés par leur lourd attirail (canons, armures, hallebardes, chevaux et chaises à porteur !) parfaitement inadapté à la jungle, sa dense végétation, ses marécages boueux et sa chaleur
suffocante, les conquistadors se retrouvent bien vite bloqués dans leur progression.
Les soldats sont accompagnés de femmes de la noblesse, de quelques esclaves maures et d’une dizaine d’indiens considérés comme des bêtes de somme.
Le chef de l’expédition charge donc le noble Don Pedro De Ursua (Ruy Guerra) de chercher du secours par la voix fluviale.
De Ursua embarque donc avec sa femme Inez de Antinazi (Helena Rojo), son lieutenant Don Lope de Aguirre (Klaus Kinski) et sa fille Flores (Cecilia Rivera), le prêtre missionnaire Don Gaspar de
Carjaval (Del Negro ) principal narrateur de l’histoire et une vingtaine d’hommes soldats et porteurs indiens.
Mais les dangers combinés du fleuve et des indiens de la foret par essence hostiles aux hommes blancs, vont s’avérer être mortels pour les soldats.
Plus grave, Aguirre homme implacable, dur et avide de pouvoir va réaliser un coup de force et destituer De Ursua de sa légitimité.
Mué en dictateur avide de richesse, Aguirre va éliminer physiquement ses opposants, nommer un empereur fantoche du nom de Don Fernando de Guzman ( Peter Berling), et enfin contraindre De
Ursua blessé par balle et sa femme à la captivité après qu‘il fut gracié par le nouvel empereur.
Même de Carjaval prend lâchement parti pour le nouveau chef et abandonne De Ursua.
La suite du film consiste en une longue progression à travers les méandres d’un fleuve mortel, dans l’attente des flèches empoisonnées des indiens anthropophages, avec l’épuisement des ressources
alimentaires et les inévitables tensions apparaissant entre des hommes poussés à la limite de leurs forces.
De Guzman tué par ses hommes parce qu’il mangeait trop, Aguirre a alors tout le loisir de faire exécuter de Ursua dans une scène poignante ou le noble exténué et impuissant accepte sans broncher
son sort.
Encore plus déchirant, sa femme ne supportant pas sa mort s’enfonce dans la foret pour un voyage sans retour.
Les hommes tombent donc un par un tandis qu’Aguirre sombre dans la folie de ses rêves démesurés s’accrochant à son désir de gloire et de richesse.
Le tyran entrainera toute l’équipe vers l’anéantissement qui n‘épargnera pas non sa propre fille.
Le film se termine sur une scène d’une force inouïe ou le conquistador arpente nerveusement seul son radeau dérivant avec ses hommes morts agonisants, tandis que des hordes de singes investissent
le bord.
Solitude du dictateur sanguinaire aveugle et paranoiaque …
En conclusion, « Aguirre la colère de Dieu » est un pure chef d’œuvre du cinéma, une œuvre inclassable, un délire autour de la quête d’un absolu inatteignable et de la folie des hommes
se prenant pour des dieux.
Outre l’approche intéressante de la quête du pouvoir menant pour l’homme déterminé à toutes les pires exactions, le film est une vibrante critique des volontés occidentales de colonisation.
L’échec cuisant que rencontre l’expédition face à des forces naturelles qui la dépassent de beaucoup montre clairement toute la vanité de cette entreprise.
La religion est elle aussi taillée en pièce, car se rangeant toujours du coté des forts pour accroitre elle aussi son pouvoir et demandant la mise à mort d’un chef indien qui n’avait pas par
ignorance reconnu une bible.
Mais plus que ces approches en elle seule captivantes, « Aguirre, la colère de Dieu » passionne par son ambiance exotique, mystique, son rythme lent, hypnotique, la beauté des images
magnifiquement mise en musique par les synthétiseurs de Popol Vuh.
On soulignera enfin, la qualité impressionnante du jeu des acteurs, particulièrement émouvants, mais surtout la présence dévorante de Klaus Kinski acteur fou et génial, parfait en conquistador
mégalomane.
On pourra ranger ce pur joyau de cinéma aux cotés de « Apocalypse now » de Francis Ford Coppola ou du plus récent « Valhalla Rising » de Peter Winding Refn.
23 juillet 2011
6
23
/07
/juillet
/2011
09:17


Après avoir connu une passe difficile dans les années 90 avec le départ de Bruce Dickinson et son remplacement par Blaze Bailey qui fut loin de faire l’unanimité, Iron maiden retrouve son
chanteur original et sort au début du nouveau millénaire « Brave new world ».
Comme si le retour de Dickinson ne suffisait pas, les anglais réintègrent également Dave Murray ce qui porte à trois le nombre de guitaristes avec Jannick Gers présent depuis 1990.
Je vous ai déjà dit combien quelques fois on pouvait s’attacher à un disque qui vous rappelle une période de votre vie qu’elle soit heureuse ou malheureuse.
C’est le cas avec « Brave new world » avec une période plutôt heureuse de ma vie, rimant avec jeunesse, audace, soleil, liberté et surtout premier inoubliable concert des anglais à
Bercy avec Slayer en première partie.
Difficile donc sans doute pour moi d’etre pleinement objectif mais autant s’atteler le plus dignement possible à la chronique de ce disque inspiré du roman d’Aldous Huxley « Le meilleur des
mondes », preuve que les hard rockers lisent aussi (parfois) des livres entre deux cuites et deux virées en moto.
L’album tant attendu débute dans le bon sens avec « The wicker man » , titre single idéal en raison de son rythme rapide et de ses refrains entrainants.
Du travail impeccable de vieux routiers maitrisant leur art.
Changement d’ambiance avec « Ghost of the Navigator » long et lent dont le thème maritime fait penser à « The rhyme of the ancient mariner » mis à part que ce titre plus
modeste et équilibré réussit fort bien à émouvoir en raison des grandioses lignes de chant de Dickinson.
On retrouve le même type de construction longue et dense avec « Brave new world » que de magnifiques refrains épiques contribuent à enflammer et à élever au rang de classique puis avec
« Blood brothers » également de bonne qualité bien qu’un cran moins prenant.
« The mercenary » tente de briser cette dynamique en insufflant plus de vitesse mais cet effet est immédiatement annulé par les neuf minutes de « Dream of mirrors » .
D’ordinaire assez réfractaire aux titres à rallonge, j’avoue avoir été capté par ce morceau complexe à l’ambiance progressive traversé d’épars passages plus puissants.
On se bouge un peu avec « The Fallen angel » plus rythmé bien que très classique pour du Maiden avant de replonger dans une ambiance progressive néo orientale sur « The
nomad » s’étalant également sur plus de neuf minutes.
Même si Iron maiden a déjà utilisé ce type d’influence par le passé (« Powerslave » « To tame a land » ) , le chant haut en couleur de Dickinson rend formidablement et
fait agréablement passer ce titre épique.
Inutile d’espérer des titres plus compacts et agressifs, cette tendance à la longueur et à la mélodie durera jusqu’au terme du disque.
Influencé par la science fiction, « Out of the silent planet » demeure plaisant par ses refrains puissants martelés avant de lancer le dernier titre « The thin line between
love and hate » sans doute le titre le moins marquant avec son ambiance rock progressive hyper mélodique.
En conclusion, bien que relativement atypique « Brave new world » marque un retour réussi pour Iron maiden.
Le style pratiqué est moins incisif et moins puissant que celui du heavy metal des années 80, les morceaux sont incroyablement longs, lents et truffés d’influences progressives mélodiques.
A priori ce style me rebute mais la qualité est ici au rendez vous et le chant exalté de Bruce Dickinson permet de conserver l’intensité nécessaire pour ne pas décrocher.
Iron maiden continuera par la suite dans ce style, avec selon moi moins d’inspiration et de réussite, finissant par se recycler lui-même, mais ceci est une autre histoire.
Mes souvenirs ne m’ont donc pas trahi, « Brave new world » est un très bon album de heavy métal adulte et intello.
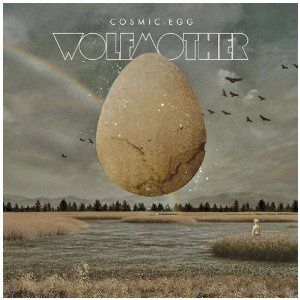
![]()




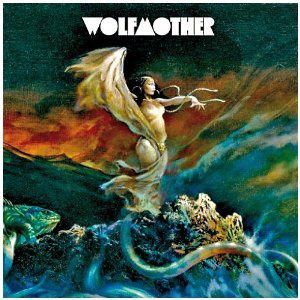





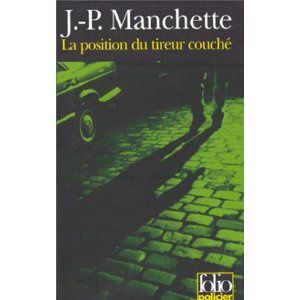


/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)