16 août 2011
2
16
/08
/août
/2011
20:59
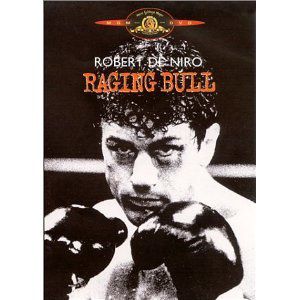

La boxe a toujours occupé une part importante dans ces colonnes, aussi est-ce avec un grand plaisir que je vais ici m’intéresser à « Raging bull » de Martin Scorcese.
Sorti en 1980, « Raging bull » raconte la vie du boxeur italo américain Jake Lamotta (Robert De Niro) , champion du monde des poids moyens dans les années 50.
Entrainé par son frère Joey (Joe Pesci) , Jake est un enfant du quartier italien du Bronx ou il a forgé sa dureté légendaire.
Forte tête, indépendant, il refuse contrairement à son frère de fréquenter de trop prêt la mafia locale qui pourrait pourtant lui faciliter son ascension au titre.
Un jour à la piscine de quartier, Jake à le coup de foudre pour Vickie (Cathy Moriarty) belle blonde platine qui fréquente quelques mafieux locaux comme Salvy Batts (Franck Vincent) ennemi juré
de Jake.
Mais Jake vit une passion à l’état le plus brut qui lui fait quitter sa femme et ses enfants pour épouser la belle.
Parallèlement à sa tumultueuse vie privée, Jake s’entraine dur et combat Sugar Ray Robinson (Johnny Barnes) boxeur élégant et surdoué, antithèse parfaite du style violent et heurté de celui qu’on
surnomme le taureau du Bronx.
Ces combats épiques entre Lamotta et Robinson seront magnifiés par le noir et blanc de la caméra de Scorcese.
Bien qu’ayant une fois détrôné le champion et décroché la ceinture puis défendu son titre face à plusieurs challengers dont le français Marcel Cerdan, Lamotta est finalement victime de son
tempérament instable.
Autodestructeur, jaloux jusqu’à la pathologie, Lamotta soupçonne sans cesse ses proches dont sa femme et son frère de le tromper.
Battu encore une ultime fois par Robinson, Lamotta finit par perdre Vicky et Joey qui ne supportent plus sa brutalité incontrolable.
Il arrête donc la boxe, prend une vingtaine de kilos, achète un cabaret de nuit qui ne tarde pas à faire faillite après des problèmes de moeurs.
Lamotta finit sa vie de manière minable, seul, obèse et fauché dans la déchéance absolue dans ce qui symbolise le mieux la grandeur et la décadence des boxeurs les plus flamboyants.
En conclusion, « Raging bull » est un grand, un très grand film sur la boxe.
Plus sombre, âpre et pessimiste (certains diront réaliste !) que le « Rocky » de Sylvester Stallone sorti quatre ans plus tôt, « Raging bull » est incarné par de
formidables acteurs, De Niro en tête avec ses ahurissantes transformations physiques et une technique de boxe des plus crédibles.
Scorcese décrit ce qu’il connait le mieux, le monde des émigrés italo-américains, petits voyous hauts en couleur, gérant de manière familiale leur petit pré carré.
Sa caméra rend un hommage élégant à ce sport violent et magnifique ou deux hommes vont physiquement au bout d’eux meme dans un affrontement ultime issu du fond des ages.
Doué mais brutal et instable, Lamotta parait comme un homme à la personnalité incontrolable le menant inexorablement au néant.
Beaucoup de boxeurs comme Christophe Tiozzo ont malheureusement connu des parcours analogues.
Aujourd’hui beaucoup considèrent avec raison « Raging bull » comme le meilleur film de tous les temps sur le noble art.
16 août 2011
2
16
/08
/août
/2011
20:24


J’ai déjà exprimé plusieurs fois en ces colonnes quelques réserves sur les œuvres de Philip K Dick.
Mais persévérant j’ai tout de même malgré celles-ci lu « Le maitre du haut château ».
Ecrit en 1962 donc dans une phase de jeunesse, « Le maitre du haut château » est une urochronie décrivant le monde post seconde guerre mondiale mais après que les Allemands et les
Japonais aient remporté la victoire sur les troupes Alliées.
Les Japonais occupent donc toute la zone pacifique dont les Etats Unis, les Allemands l’Europe dont la Russie.
Les Nazis ont pu mettre en œuvre leurs plans de génocide à une échelle planétaire, faisant de l’Europe de l’Est un désert et étendant leur puissance de destruction au continent africain qui a
servi de gigantesque laboratoire à leurs volonté d’extermination rationnelle.
Même si économiquement le régime du III iéme Reich est un désastre, les découvertes scientifiques de la seconde guerre mondiale ont permis aux Nazis de se lancer dans la conquête spatiale avec
des volontés de colonisation.
Hitler à bout de course estici dans un asile psychiatrique et c’est Martin Bormann son bras droit qui a pris la suite.
Bien que réduits à l’état de citoyens de seconde zone dans leur propre pays, les américains sont tout de même mieux traités par les Japonais qui les ont simplement colonisés sans les
massacrer.
Dans ce monde américain remodelé, Dick fait graviter plusieurs personnages, Robert Childan, antiquaire, qui vend des objets de collections aux Japonais envers qui il a développé un fort complexe
d’infériorité, Franck Frink, ouvrier d’origine juive qui après quelques magouilles concernant la falsification d’objets d’art cherche à se reconvertir dans l’artisanat, son ex femme Juliana
devenue professeur de judo qui fréquente un mystérieux italien nommé et le japonais Monsieur Tagomi, représentant du consul japonais qui attend un commercial suédois nommé Monsieur Baynes pour un
rendez vous d’affaire.
Il s’avère en réalité que Baynes n’est pas suédois mais un agent de l’espionnage allemand (Abwehr) qu’une faction divergente de SD Nazis va chercher à récupérer.
En toile de fond du récit figure « La Sauterelle » un livre interdit et scandaleux écrit par un auteur se terrant dans les Montagnes Rocheuses, Hawthorne Abendsen.
Ce livre raconte de manière fictionnelle la monde tel qu’il serait si les Forces de l’Axe avait perdu la guerre.
Abendsen fascine surtout Juliana et Joe qui décident sur un coup de tête d’aller rencontrer l’écrivain.
Mais Juliana découvre que Joe est en réalité un tueur de la Gestapo et l’élimine après une scène particulièrement mouvementée.
La mort subite de Bormann provoque de forts bouleversements dans l’échiquier politique mondial avec une intense guerre de succession que se livrent les hommes forts du Reich, guerre finalement
gagnée par Goebbels.
Tagomi empêche in extremis un commando nazi d’enlever Barnes mais l’usage qu’il fait de la violence perturbe profondément ses croyances pacifiques.
L’incident provoque d’ailleurs de forts remous dans les relations diplomatiques germanico-nipponne et vaut à Frink une relaxe après une histoire de falsification d’objets d’art.
Le livre se termine par la rencontre entre Juliana et Abendsen, qui lui révèle par gratitude qu’il a écrit son livre ne sa basant sur le Yi King le livre chinois des Oracles qui régit la vie
quotidienne des territoires japonais, ce qui jette un trouble intense sur la réalité de l’histoire décrite par Dick.
En conclusion, « Le maitre du haut château » est un livre vraiment étrange et parfois déroutant ayant le mérite de provoquer une intense réflexions sur un possible non avenu.
Dans ce monde cauchemardesque régi par les Nazis, les Japonais font curieusement figure de modérés alors qu’on découvrit pourtant dans les années 80, l’existence de camps de concentration et
d’horribles expérimentations pseudo scientifiques comme la tristement célèbre unité 731 de Mandchourie.
Je trouve donc Dick trop bienveillant dans sa vision d’un monde régi par les Japonais.
Autre critique, la totalité de l’action se passe aux Etats Unis, le reste du monde n’étant que lointainement évoqué.
On ne sait ainsi rien de l’Europe de l’Ouest, de l’Amérique Latine, de l’Inde, ni du Moyen Orient et on comprend tout juste dans cette vision américano centrée que les Africains (noirs) et les
Chinois ont été réduits en esclavage voir davantage.
Difficile également d’adhérer à la personnalité des personnages, tant les situations dans lesquelles ils se retrouvent sont bizarres et déroutantes.
Dick est en revanche meilleur dans l’évocation de la psychologie des américains mis pour la première fois en position d’infériorité, dans la description des rapports de forces entre les
dirigeants du Reich, Heydrich, Goering, Himmler, Goebbels et n’hésite pas à prendre ouvertement la défense des juifs persécutés.
La fin du livre est également astucieuse, avec cette pirouette sur ce qui est finalement réel ou sur ce qui ne l’est pas.
Pour autant, ceci ne suffira pas encore cette fois à me faire basculer du coté des admirateurs du gourou américain de la Science Fiction.
12 août 2011
5
12
/08
/août
/2011
21:17
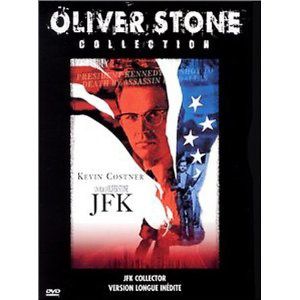

Sorti en 1992, « JFK » d’Oliver Stone est assurément l’une des œuvres les plus impressionnantes de ce cinéaste controversé.
Gonflé, le réalisateur s’attaque cette fois ci à un mythe, à l’un des plus grands mystères du XX iéme siècle, l’assassinant du président des Etats Unis d’Amérique John Fitzgerald Kennedy le 22
novembre 1963 à Dallas.
Son film d’une durée de trois heures, s’appuie sur le personnage de Jim Garrison (Kevin Costner) procureur de la Nouvelle Orléans, qui par une ténacité hors du commun déterra en secret l’affaire
Kennedy trois ans après pour tenter de découvrir qui étaient les commanditaires de cet assassinat.
Homme intelligent, intègre et mu par une soif de vérité inarrêtable, Garrison s’entoure d’une petite équipe d’enquêteurs fidèles comme le jeune Bill Broussard (Michael Rooker) ou le costaud Lou
Ivon (Jay O Sanders).
Il s’intéresse tout d’abord à la vie opaque de Lee Oswald (Gary Oldman impressionnant ) l’assassin présumé comme solitaire par la commission Warren ayant enquêté en 1963, pour découvrir un agent
double américain ayant infiltré les soviétiques avant de revenir aux États-Unis une fois sa mission accomplie en URSS.
Membre des services secrets, Oswald s’est fait passer pour un militant communiste afin d'infiltrer les milieux castristes des Etats Unis.
Il a aussi côtoyé des para militaires cubains comme David Ferrie (Joe Pesci égal à lui-même en teigne survoltée) ou un mystérieux homme d’affaire nommé Clay Shaw (Tommy Lee Jones), tous les deux
liés par de même tendances homosexuelles.
Garrison est persuadé que c’est dans ce cercle para militaire en cheville avec la CIA que se situe la clé de l’énigme et que Oswald n’est qu’un bouc émissaire ayant servi à couvrir un complot
d’envergure impliquant des hommes haut placés dans le gouvernement américain de l’époque.
Pour étayer sa thèse, Garrison relève les invraisemblances du dossier, comme la non prise en compte par la commission Warren des témoins oculaires qui avaient vu un deuxième foyer de tirs depuis
une palissade, comme les discordances entres les blessures de Kennedy et les nombre de balle supposées tirées par Oswald.
Il reçoit aussi le témoignage d’un ancien colonel membres des forces spéciales (Donald Sutherland) qui lui indique les défaillances dans les services de protection du président à Dallas et lui
révèle que Kennedy qui s’apprêtait à se désengager de la guerre du Viet Nam gênait les militaires en haut lieu.
Il agit aussi, désireux de trainer Ferrie et Shaw devant des tribunaux en utilisant le témoignage de Willy O’Keefe (Kevin Bacon) taulard homosexuel proche de Shaw, affirmant avoir entendu le
groupe parler d’assassiner le président.
Mais alors que Ferrie s’apprête à craquer sous la pression il est éliminé.
L’affaire se complique quand l’enquête de Garrison est révélée au grand jour.
Il est soumis à des pressions, sa famille est menacée, son groupe explose …
Pourtant il tient bon et parvient à trainer Shaw devant la justice.
Sans charge sérieuse, sa tentative échoue pourtant non sans que le procureur ait accusé dans une longue et vibrante plaidoirie, le président des Etats Unis Lyndon Johnson d’être impliqué dans le
meurtre.
Le film termine sur cet échec mais relate qu’une deuxième commission réunie en 1976 a confirmé la thèse du complot que soutenait le procureur.
En conclusion, quelle que soit la solidité de la thèse défendue par Oliver Stone, « JFK » est un film extrêmement prenant qui captive malgré la complexité de l’enquête mélangeant
allégrement politiques, mafieux, agents secrets et militaires.
On suit le déroulement de l’enquête avec passion, en admirant les qualités humaine du procureur incarné par un Kevin Costner je dois l'avouer ici impeccable en bureaucrate se sentant
investi d’une mission pour le peuple américain qui le galvanise et lui fait oublier tous les obstacles.
Les autres acteurs sont évidemment tous très bons, en particulier Gary Oldman fantastique de sobriété ou Tommy Lee Jones curieusement efféminé avec une perruque frisée blanche.
Sur le fond, l’histoire fascine toujours … il y a l’incroyable violence de la scène de la fusillade avec le crane de l’homme le plus puissant du monde qui explose en direct sous l’impact et sa
femme, la splendide Jacky qui tente de lui porter assistance dans un geste de magnifique dramaturgie.
Si le rôle de la Mafia est (à mon avis fort justement) minimisée, celui des politiques et des services secrets est fortement mis en avant.
Kennedy était un pacifiste, il voulait aider les plus démunis, les minorités, signer des traités de paix avec les Soviétiques, voulait se retirer de la guerre du Viet Nam et mettre la pression
sur la Mafia … il dérangeait donc les plans de beaucoup d’hommes puissants qui profitaient de la situation de conflit avec le bloc communiste et avaient tout intérêt à la poursuite des programmes
militaires de la guerre froide.
Les assassinats de Luther King, de son frère Bobby mais également de Oswald ou les morts mystérieuses des témoins du dossier jettent également de fortes suspicions sur la thèse d’un fou ayant agi
seul.
Pour connaitre la vérité, attendre 2029 et l’ouverture des dossiers secrets de 1963 au public, serez vous présents avec moi ?
12 août 2011
5
12
/08
/août
/2011
20:12


Solidement établi après trois albums au retentissement mondial, Nightwish essuie de fortes zones de turbulence en 2002 qui se soldent par le départ du bassiste Sami Vanska remplacé par Marco
Hietala.
Mais malgré les rumeurs de départ de la chanteuse Tarja Turunen, le groupe fait front, se ressoude et sort en 2004 un « Once » très attendu.
Avec sa pochette insipide en phase avec l'imagerie gothique soft du groupe, « Once » débute en force avec « Dark chest of wonders » véritable bande originale de film ou
claviers épiques, guitare lourde et chant néo-classique forment un mélange aussi étonnant que détonnant.
Le London Studio Orchestra et ses cinquante deux musiciens recrutés pour l’occasion sont pour beaucoup dans l’impact monstrueux du son.
La deuxième salve vient juste derrière avec l’impeccable « Wish I had an angel » tube parfait aux refrains ultra rythmés et entrainants mélangeant voix féminine et masculine de Marco
Hietala.
Qu’on le veuille ou non c’est proprement irrésistible.
Logiquement Nightwish calme le jeu sur la jolie ballade « Nemo » à la délicieuse mélodie susurrée par la voix angélique de Tarja.
L’inspiration néo-classique est encore une fois génialement mise en avant avec « Planet hell » belle pièce violente et épique.
Puis vient une audacieuse tentative, le croisement avec les chants d’indiens d’Amérique du nord sur « Creek mary’s blood » pour un résultat plutôt réussi dans son originalité et sa
dignité.
Plus convenu est l’influence orientale de « The siren » ou la douce ballade en trompe l’œil « Dead garden ».
Le groupe tâtonne, se fait plus agressif sur « Romanticide » plombé par une structure tortueuse, des riffs lourdingues et des refrains ralentis puis revient avec « Ghost love
score » à une ambiance néo-classique mélodique ou reconnaissons le il excelle.
L’album se finit en douceur sur deux ballades sans intérêt, « Kuolema Tekee Taiteilijan » et son chant en finlandais puis « Higher than hope » pénible à souhait.
En conclusion, après un début fantastique sur sa première moitié avec des morceaux punchy, accrocheurs à l’étonnante qualité, « Once » s’essouffle graduellement dans sa seconde moitié
finissant même par complètement s’écrouler dans sa dernière ligne droite comme un coureur de 400m ayant présumé de ses forces.
Au final, le résultat est bien entendu à la hauteur, avec le style épique du groupe gonflé par les performances de l’orchestre symphonique et quelques petite innovations bien tentées en
supplément.
Malgré cette belle réussite, « Once » sera le dernier album avec Tarja Turunen au micro, la belle chanteuse à l’aura écrasante préférant quitter le groupe pour tenter une carrière solo
des plus risquées.
Personne au final n’a à regretter la belle aventure, Nightwish est devenu une des pointures de la scène métal avec un public fidèle jeune assez proche des milieux gothiques et Tarja après cinq
albums de qualité s’est procurée la notoriété suffisante pour ne pas à avoir à regretter d’avoir arrêté ses études de musique classique.
Beaucoup de formation de moindre niveau se sont engouffrées dans la brèche des groupes de métal mélodique à chanteuse, tentant de capter avec moins de réussite le fantastique succès des
Finlandais.
Ce départ ne marquera pas pour autant la fin du groupe, Holopainen réussissant en 2007 à recruter une nouvelle chanteuse pour incarner sa musique mais tout ceci est une autre histoire ...
10 août 2011
3
10
/08
/août
/2011
19:38


En pleine phase de recherche personnelle et de découvertes en tout genre y compris musicales, j'ai découvert par hasard en 2000 le groupe de metal symphonique finlandais Nightwish et à l’époque
ait été immédiatement séduit par « Wishmaster ».
Né d’une idée curieuse et audacieuse du claviériste Tuomas Holopainen, Nightwish est la synthèse entre le chant d’influence lyrique de Tarja Turunen issue de la musique classique et le style
heavy métal mélodique représenté par la guitare de Erno Vuorinen, la batterie de Jukka Nevalainen puis par la basse de Sami Vanska qui rejoint le groupe pour leur deuxième album
« Oceanborn ».
Après le succès surprise d’ « Oceanborn » en 1998, le groupe décide d’enfoncer le clou en 2000 avec « Wishmaster ».
Vous l’aurez compris à la pochette assez infantile et niaise, l’univers de Nightwish est assez loin de celui d’un Slayer.
Fidèles à leurs habitudes, les Finlandais démarrent par « She is my sin » titre aux riffs et aux refrains accrocheurs porté par le chant complètement atypique de Turunen ou Tarja comme
la nomment affectueusement les fans enamourés de la plastique de la belle scandinave.
Le ton se durcît et le coté épique, théâtral du groupe s’affirme avec « Kinslayer » , morceau sombre doté d’une vitalité étonnante renforcée par le chant masculin présent en
soutien.
Après cette belle déflagration on est cueilli en traitre par les irrésistibles montées mélodiques de « Come cover me ».
Avec ses claviers trop prononcés et ce coté speed mélodique qui tombe à plat, « Wanderluste » déçoit et cette déception n’est pas complètement rattrapée par la ballade un peu trop
larmoyante « Two for tragedy » .
Nightwish redresse formidablement le cap avec assurément son meilleur titre « Wishmaster » véritable hymne d’opéra métal dont la dynamique puissante et les refrains heurtés rappellent
parfois le Carmina Burana de Carl Orff.
Tout le savoir faire du groupe est présent dans ce titre majeur, puissance, grâce, et surtout ce coté mélodique si formidablement accrocheur.
Sur leur lancée, les Finlandais enchainent avec « Bare grace misery » agréable douceur sans conséquence puis « Crownless » également teinté de speed mélodique difficilement
ingérable et enfin « Deep silent complete » formidable ballade illuminée par le chant inspirée de Tarja et par le groove fantastique insufflé par les musiciens.
La mélancolie est également de mise sur l’acoustique et plat « Dead’s boys poem » heureusement rapidement oublié par le final en forme de feu d’artifice « Fantastic me »
rapide, intense, soutenu et truffé de superbes intonations lyriques avec en son sein un break central fort réussi.
En conclusion, groupe atypique et original, Nightwish décrocha la timbale avec ce « Wishmaster » misant sur des mélodies ultra efficaces et sur le chant à l’époque hors du commun dans
ce cadre de sa chanteuse dont le physique de brune aux yeux verts ne fit qu’accentuer les effets dévastateurs sur les cœurs on le sait plus sensible qu’il n’y parait de ces faux durs de
rockers.
Avec le recul mon enthousiasme a quelque peu fléchi, le groupe possédant un indéniable coté accrocheur mais ce coté finalement assez commercial et bien huilé pouvant agacer l’amateur de musique
plus instinctive et sauvage que je pense être.
Je dis souvent que Nightwish est le groupe parfait pour convaincre les réfractaires au hard rock que cette musique peut aussi se montrer sous un jour plus séduisant car incorporant des éléments
(classiques symphoniques) propres à la rendre plus grand tolérable auprès du grand public.
Cependant, malgré toutes ses qualités, Nightwish demeure pour moi une curiosité exotique non indispensable.
10 août 2011
3
10
/08
/août
/2011
18:29


J’ai toujours trouvé que la psychanalyse était un domaine aussi fascinant qu’effrayant, aussi est-ce avec un mélange d’excitation et d’inquiétude que j’ai découvert Sigmund Freud avec « Sur
le rêve ».
Ecrite en 1900 soit il y a plus d’un siècle, « Sur le rêve » est une version allégée et sensée plus accessible de la volumineuse « interprétation des rêves » parue peu
avant.
Le célèbre psychiatre autrichien y développe ses idées sur l’analyse des rêves en les illustrant de quelques exemples soit issus de sa vie personnelle, soit de son expérience de praticien.
Il sépare les rêves des enfants facilement interprétables car non refoulés de ceux des adultes plus complexes qu’ils soient cohérents ou incohérents centrés sur un désir refoulé.
Dans les rêves des adultes, plusieurs phénomènes opèrent simultanément comme la condensation qui agrège différents éléments latents de l’inconscient pour produire le contenu manifeste du rêve
conscient ou chacun de ces éléments se trouve mêlé aux autres pour produire la toile d’ensemble.
Le phénomène de déplacement modifie la place des composants du rêve pour en atténuer ou en augmenter facticement l’importance.
La transformation opère par des procédés complexes généralement très symboliques.
Puis enfin le phénomène de traitement donne un ordre apparent au rêve constitué pour en masquer la signification réelle.
Freud décrit la raison d’être de ces phénomène par la notion centrale de refoulement qui censure à l’état de veille tous nos inavouables désirs majoritairement érotiques car jugés profondément
inconvenant par les règles de la civilisation.
Relégués dans notre inconscient, ces désirs refoulés profitent de l’état de sommeil pour s’exprimer par l’intermédiaire des rêves.
Mais la censure bien que partiellement relâchée, veille à masquer le sens de ces désirs dont l’existence est par trop dérangeante.
Le travail du psychiatre consiste alors à dénouer les fils des pensées enchevêtrées, à remettre les choses à leur place et à décrypter les symboles ou les transformations venant brouiller les
cartes.
Freud complète son analyse par l’affirmation de l’influence de stimulus extérieurs comme un événement récent marquant jouant le rôle de déclencheurs, de celle de l’enfance puis enfin de
dispositifs de protection internes servant alternativement à protéger le sommeil du rêveur ou à le réveiller en cas d’angoisse trop importante.
En conclusion, même si un siècle après les théories de Freud sont aujourd’hui logiquement critiquées, j’ai trouvé « Sur le rêve » une fois décrypté le jargon du psychiatre
globalement passionnant.
L’approche de Freud se distingue par la négation du coté surnaturel des rêves apparue dès l'Antiquité, de leur connexion avec le monde de l’au-delà, de leur capacité à prédire le futur mais aussi
de l’approche matérialiste ne voyant qu’un simple travail des organes et n’attribuant aucune valeur à ces phénomènes incompréhensibles.
Il introduit une théorie basé sur le refoulement de nos désirs profonds nés de l’enfance et de nos pulsions sexuelles.
Pour autant le livre ne dit pas pourquoi nous éprouvons ce besoin physiologique, Est-ce parce que le stockage de ses désirs enfouis dans notre inconscient nous rendrait au final fou ?
L’esprit trouvant alors un compromis acceptable en les évacuant partiellement dans cet espace réservé ou nul dommage physique ou moral n’est à craindre ?
Beaucoup de questions levées donc sur un domaine que les scientifiques n’ont sans doute pas fini d’explorer.
Published by Seth
-
dans
Psychologie
Surlereve
Freud
9 août 2011
2
09
/08
/août
/2011
21:09
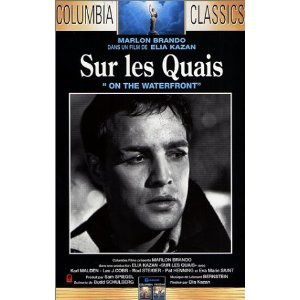

La lecture récente de la biographie de Marlon Brando m’a assurément donné envie de redécouvrir la filmographie de cet immense acteur.
Alors pourquoi ne pas commencer par le film qui lui donna son premier oscar, « Sur les quais » de son mentor Elia Kazan en 1954 ?
Réalisé en noir en blanc, « Sur les quais » décrit le monde des dockers de New York dans les années 50, un monde dur, masculin mais surtout gangrené par le chef mafieux Johnny Friendly
(Lee J Cobb) qui impose ses règles, détourne des marchandises et déclenche des grèves pour faire pression sur les armateurs pris à la gorge.
Terry Malloy (Marlon Brando) , ex boxeur prometteur ayant arrêté sa carrière prématurément pour tomber sous la coupe de Friendly est impliqué dans le meurtre de Doyle, un docker qui s’apprêtait à
dénoncer le mafieux à la police.
De plus, son propre frère Charley (Rod Steiger) est un avocat véreux travaillant pour le mafieux.
Ebranlé par la gravité de son acte, Terry est rongé par un sentiment de culpabilité qui se manifeste par un rapprochement avec la sœur du défunt la belle Edie Doyle (Eva Marie Saint) qui
suit des études d’institutrice pour tenter d’échapper à la pauvreté et à la violence du monde des dockers.
Un trouble jeu de séduction va s’instaurer entre eux et Edie va peu à peu ouvrir les yeux de Terry sur la mauvaise voie qu’il a choisie.
Terry est également influencé par le père Barry (Karl Malden) qui pousse les dockers à dénoncer le système mafieux de Friendly à la police.
Mais Friendly est prêt à tout et n’hésite pas à user de violence pour éliminer les candidats au témoignage comme le costaud et courageux Dugan (Pat Henning).
Cité à comparaitre par la police pour le meurtre de Doyle, Terry accepte de se rendre à la convocation malgré les pressions du gang de Friendly.
Charley tente de dissuader son frère de témoigner pour lui éviter d’être assassiné mais devant son refus de plier, il ne trouve pas le courage de le livrer aux tueurs de Friendly, acte qu’il
parait de sa vie.
Ivre de rage, Terry prend une arme et décide d’éliminer lui-même Friendly mais Barry le dissuade in extremis, lui intimant d’user de la voix légale.
Après la comparution, Friendly furieux fait mettre Terry au banc des dockers et le prive de travail.
Terry s’en prend alors physiquement au mafieux devant des dockers pétrifiés qui laissent ses gardes du corps frapper durement le rebelle.
Puis touchés par le courage du jeune homme, ils prennent alors la décision de ne reprendre le travail qu’une fois Terry réintégré.
Le film s’achève sur la foule des dockers bousculant un Friendly impuissant pour suivre un Terry ensanglanté reprenant le chemin du travail.
En conclusion, « Sur les quais » est un film magnifique, dur, viril mais passionnant sur un monde relativement méconnu et à vrai dire plutôt effrayant.
Le coté « travailleur manuel américain » rappelle par instant le monde décrit par Huber Shelby JR dans « Last exit to Brooklyn » la défonce en moins.
Marlon Brando alors au zénith de sa beauté et de sa prestance est bien entendu magnifique en petite frappe en quête de rédemption, devenant une sorte d’élu osant prendre tous les risques pour
briser la corruption du système.
Sa relation amoureuse avec Eva Marie Saint est complexe, trouble et sensuelle mais à vrai dire tous les acteurs sont formidables de charisme en particulier Karl Malden en prêtre humaniste et Lee
J Cobb en chef mafieux aussi séduisant que brutal.
« Sur les quais » vous prend aux tripes dès sa première scène, le jeu des acteurs fait ensuite le reste pour vous emporter dans un univers puissant ou les émotions sont magnifiées.
Elia Kazan transcende son sujet pour révéler la beauté de l’humanité se terrant sous le verni de la bassesse, de la lâcheté et de la médiocrité.
Un grand et beau film qui vous donne envie d’aimer le cinéma.
8 août 2011
1
08
/08
/août
/2011
20:21


En 1969, The Who tentent avec « Tommy » l’audacieux pari de produire un opéra rock autour d’un concept album narrant les aventures d’un jeune homme sourd muet, maltraité par ses
parents, qui devient champion de flipper puis une sorte de gourou destiné à soigner l’humanité de ses fautes.
Si on est pas obligé d’adhérer au concept de cette histoire tortueuse faisant office de paraboles aux soucis de communication du guitariste Pete Townshend, on peut considérer avec intérêt les
vingt cinq pistes qui composent cette œuvre ambitieuse et à l'époque passablement novatrice.
La longue « Ouverture » quasi instrumentale lance l’annonce « It’s a boy » ou se dégage une ambiance épique (présence de chœurs, chant haut perché mélodique de Roger
Daltrey).
On a toujours l’impression d’être dans une introduction avec le calme et raffiné « 1921 ».
Rien ne décolle pourtant avec le lent « Amazing journey » et l’instrumental « Sparks » ennuyeux au possible.
On dresse un sourcil sur la mélodie de « Eyesight to the blind » (The hawker) qui ne parvient cependant pas à accrocher.
Ensuit l’album s’éveille enfin légèrement, « Christmas » contient un gimmick plutôt astucieux, « Cousin Kevin » de belles harmonies vocales et « Acid queen » enfin
le potentiel d’un titre fort.
Vient ensuite « Underture » trop long morceau instrumental de prêt de dix minutes.
Après ce morceau copieux, le format des titres se raccourcit avec les courts interludes « Do you think It’s alright ? » , « Fiddle about » à la mélodie accrocheuse puis
« Pinball wizard » sans nul doute le meilleur titre du disque car construit sur une dynamique et des riffs très rock.
« Go to the Mirror ! » alterne passage relativement rapides et doucereux puis les chœurs soutenant une mélodie plaisante sont à nouveaux à l’honneur sur le court « Tommy can you
hear me ? » avant qu’un aspect plus blues se ressente sur l‘irritant « Smash the mirror ».
Le très éthéré et soft « Sensation » précède « Sally Simpson » au groove très rythm and blues avant que n’arrive le titre les plus connu du disque « I’m free »
véritable hit aux refrains immédiatement accrocheurs.
On passe ensuite de l’atmosphère alambiqué et apaisante « Welcome » à celle de cartoon de « Tommy’s Holiday’s camp » pour aboutir à un « We’re not gonna take it »
bien gentillet compte tenu de son contenu rebelle.
L’album se termine enfin sur le très planant « See me feel me/Listinening to you » .
En conclusion, construit autour d‘un concept original et ambitieux, « Tommy » n’est globalement au final pas le disque pompeux et insupportable auquel on aurait pu s’attendre, les Who
conservant une certaine sobriété dans leurs compositions.
Le principal reproche que je pourrais lui faire est son manque d’ampleur, d’énergie, d’emphase ce qui est rédhibitoire pour un opéra.
Trop raffiné voir par moments précieux, « Tommy » ne vous emporte pas, il vous berce gentiment et le rock sauvage parait ici bien loin.
La voix de Daltrey est superbe, une des plus belles du rock mais il manque ici quelques tempos plus dynamiques et quelques riffs plus trapus pour insuffler un peu de folie à tout cela.
« Tommy » est donc pour moi un bel objet, intello, élégant et maniéré qui comporte trois titres réellement marquants et rien de plus ou de moins.
Published by Seth
-
dans
Rock
Tommy
TheWho
5 août 2011
5
05
/08
/août
/2011
20:58


Le succès de la trilogie des westerns de Sergio Léone au début des années 70 donna naissance à toute une flopée de films très fortement inspirés de l’œuvre du maitre italien.
Réalisée par Gianfranco Parolini sous le pseudonyme américain de Franck Kramer, la trilogie des « Sabata » s’étale sur trois ans entre 1969 et 1971.
Westerns de seconde zone, les « Sabata » ne présentent d’intérêt que par la présence de leurs acteurs principaux, Lee Van Cleef et Yul Brynner.
Réalisé en 1971, « Le retour de Sabata » clôt la trilogie avec le retour de Lee Van Cleef qui reprend sa place laissée à Brynner le temps d’un intérim de luxe.
C’est un Van Cleef vieillissant qui interprète Sabata ex major de la Guerre de Sécession venu récupérer de l’argent que lui doit son ex lieutenant Clyde (Reiner Schone) devenu tenancier d’une
maison de jeu dans la ville d'Hobsonville.
Après quelques tensions une fois que Sabata ait tenté de récupérer son argent en trichant dans le tripot de Clyde, les deux hommes se réconcilient temporairement, Sabata parvenant même à se
rallier les deux gardes du corps de Clyde, des acrobates aux capacités étonnantes qui lui serviront d’anges gardiens durant tout le film.
Charmeur, il gagne aussi les faveurs de Maggie (Annabella Incontrera), une belle prostituée du saloon. .
Mais Sabata s’aperçoit que la ville est sous la coupe du puissant Joe Mc Intok (Giampiero Albertini) dit l’Irlandais, qui rackette les habitants en usant de la menace d’hommes armés.
Sabata refuse de plier et un bras de fer s’engage alors avec Mc Intok dont les gorilles sont régulièrement mis en déroute.
Il gagne alors la sympathie de l’annonceur public Bronco (Ignacio Spalla), sosie barbu et bedonnant de Bud Spencer qui n’hésite pas lui aussi à délaisser Mc Intok.
S’étant mis en tête de dépouiller Mc Intok de tout l’argent qu’il a volé, Sabata et Clyde s’allient mais découvrent que l’Irlandais est en réalité un faux monnayeur.
Après de nombreuses péripéties culminant avec un classique règlement de compte au pistolet, Clyde et Sabata parviennent à mettre la main sur le véritable trésor de l’Irlandais, d’authentiques
pièces d’or cachés dans la cheminée.
Le film se termine sur une note humoristique, Sabata déjouant les stratagèmes de son allié pour lui extorquer l’or et se remboursant lui-même.
En conclusion, construit sur un scénario bâclé et fumeux, « Le retour de Sabata » est un film largement parodique jouant sur des situations comiques et des répliques volontairement
débiles tombant souvent à coté.
Homme en noir utilisant des minuscules pistolets dissimulés dans des endroits invraisemblables, Van Cleef est fidèle à lui-même, dur, droit et fier, en revanche son partenaire Schone bien que
doté d’un physique de play boy dégingandé est plus irritant que convainquant.
Les bagarres sont mollassonnes et trop téléphonées (saloon, ville) quand aux deux acrobates, leur tours sont le plus souvent involontairement ridicules.
Point positif, la musique de Marcello Giombini, délire ba(rock) aux paroles franchement hilarantes.
Un film bien médiocre donc, que seule la présence du charismatique Van Cleef sauve de la noyade absolue.
2 août 2011
2
02
/08
/août
/2011
18:42
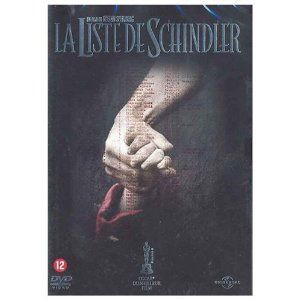

Sujet beaucoup moins plaisant a priori avec « La liste de Schindler » de Steven Spielberg.
Le cinéaste tout auréolé du colossal succès de « Jurassic Park » en 1993, réalise la même année ce film adapté d'un livre de Tom Keneally sur le sujet délicat de la Shoah.
Basé sur l’histoire (vraie) d’Oskar Schindler (Liam Neeson), industriel allemand qui sauva 1200 juifs des camps de la mort en Pologne, « La liste de Schindler » montre tout d’abord ce
héros de la seconde guerre mondial comme un individu sans scrupule, prêt à profiter de la situation de pogrom contre les juifs parqués dans le ghetto de Cracovie pour utiliser leur main
d’œuvre bon marché pour ses usines de production d’émail.
Pour gagner la confiance des juifs, Schindler embauche comme comptable Itzhak Stern (Ben Kingsley) dignitaire du ghetto, afin de recruter les travailleurs qualifiés dit « essentiels »
pour la production des usines allemandes.
Le film présente donc tout d’abord un arriviste, doté d’une belle prestance, membre du parti SS, fréquentant le gratin des militaires dans des soirées mondaines pour faire fructifier ses
intérêts.
Puis la répression à l’encontre des juifs s’intensifie, le ghetto de Cracovie est vidé avec une brutalité inouïe et les juifs sont parqués dans un camps de travail dirigé par l’infâme capitaine
Amon Goth (Ralph Fiennes) présenté comme un individu instable, dérangé, capable d’une grande cruauté et de tuer les prisonniers pour son bon plaisir sans ressentir la moindre émotion.
Subitement privé de ses ouvriers et choqué par la brutalité de la mise à sac du ghetto, Schindler va peu à peu infléchir son point de vue et proposer à Goeth de faire réimplanter son usine dans
le camps afin d’essayer de protéger ses ouvriers en corrompant le capitaine avide d’alcool, de femmes et d’argent.
Même si Schindler est convoqué par la Gestapo après avoir embrassé une juive lors de sa soirée d’anniversaire, l’industriel manœuvre bien et parvient en graissant la pattes des officiers nazis à
entretenir ses affaires.
Lors de la décision de déporter dans le camps d’extermination d’ Auschwitz les travailleurs afin de faire de la place, Schindler va prendre des risques considérables pour rapatrier ses 1200
ouvriers dans un camps-usine sous son contrôle.
Au moment ou il est ruiné et ou l’armée s’aperçoit que la production de son usine est inutilisable, Schindler est sauvé par l’annonce de la défaite de l’armée allemande.
Bien que à présent traqué, il donne avant de partir la liberté à ses ouvriers.
La fin du film assez émouvante, montre le pèlerinage des acteurs accompagnés des véritables personnage de cette histoire, sur la tombe de Schindler à Jérusalem.
En conclusion, « La liste de Schindler » et ses presque trois heures est un gros pavé lourd à digérer.
Peu de joie ou de légèreté dans ce film en noir et blanc reproduisant fidèlement les pénibles conditions de (sur)vie des juifs polonais de l’époque.
Certaines sont bien entendu difficilement soutenables, comme les tueries arbitraires de Goth ou les abominables séances de tri des prisonniers aux corps dénudés et squelettiques réduits à la
condition de bêtes.
Seule la scène des chambres à gaz nous est assez miraculeusement épargnée.
On se demande toujours avec incrédulité comme des êtres humains peuvent faire des choses pareilles à d’autres êtres humains mais l’histoire contemporaine a montré que l’être humain avait assez
peu progressé en la matière.
Bien entendu les acteurs sont épatants, en particulier Liam Neeson, monstrueux de charisme dans le plus grand rôle de sa carrière mais aussi Fiennes terrifiant de sadisme.
Spielberg a voulu son film comme puissamment éducatif, le résultat est atteint même si on en ressort finalement assez ébranlé et assez mal dans sa peau par la pénibilité du contexte.
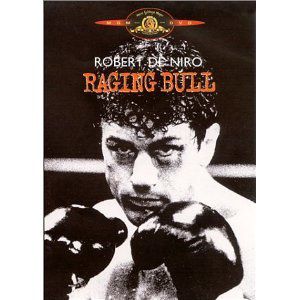
![]()





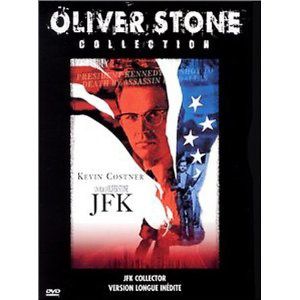



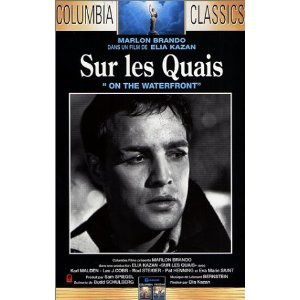


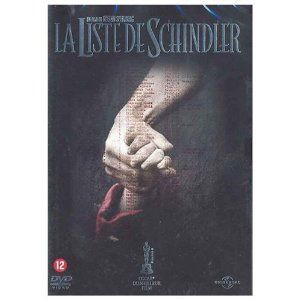
/image%2F0994838%2F20180116%2Fob_0959b4_seth2.jpg)